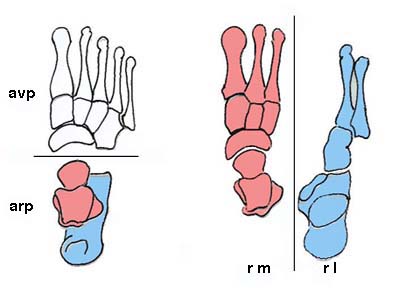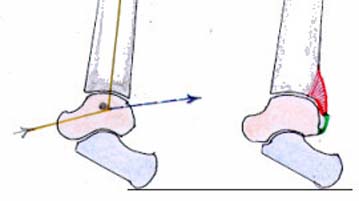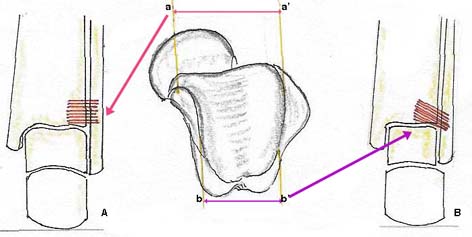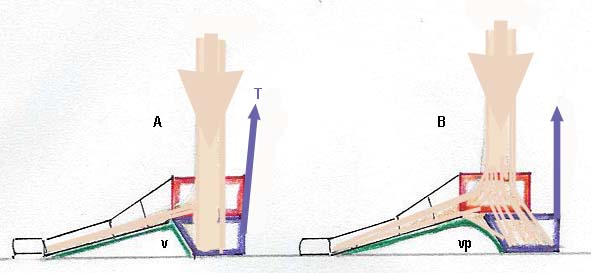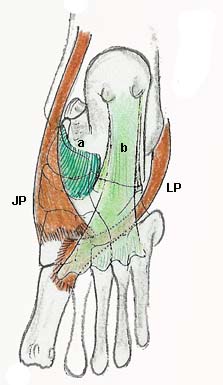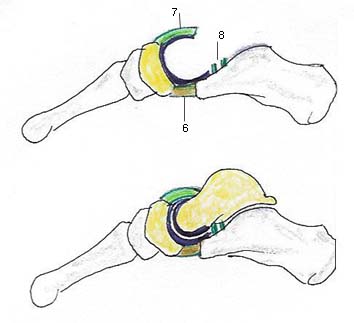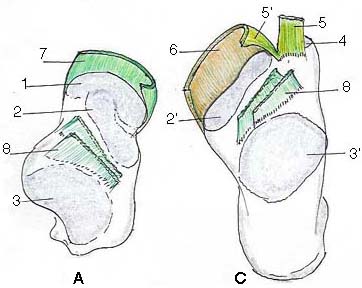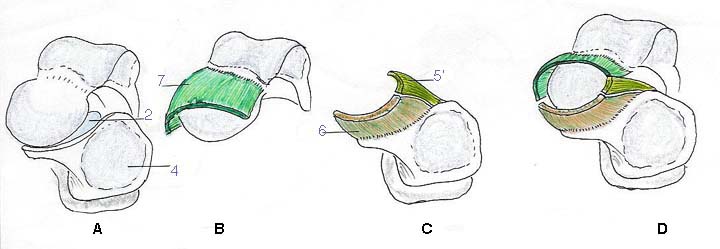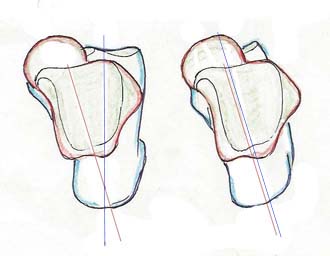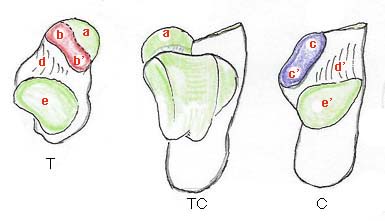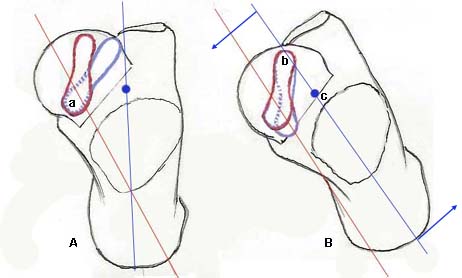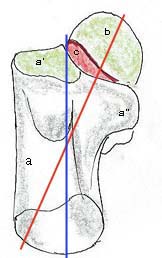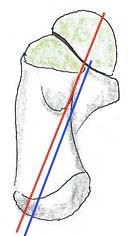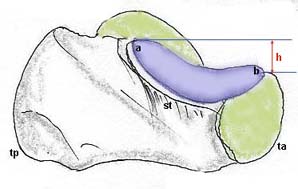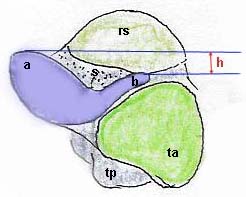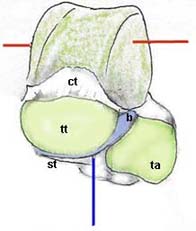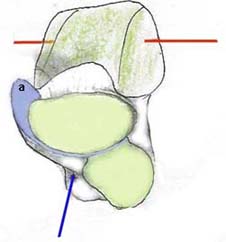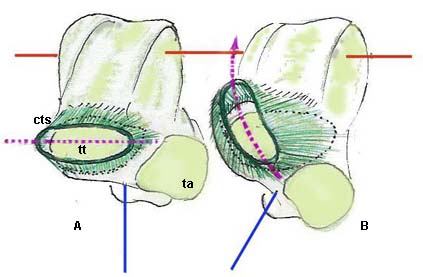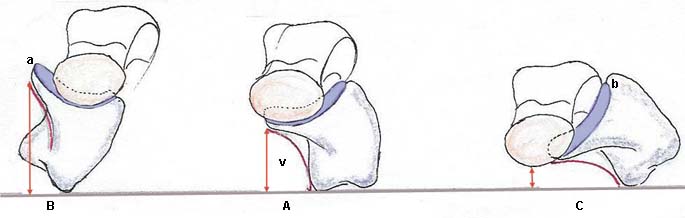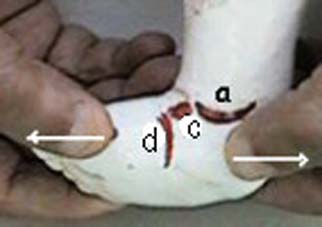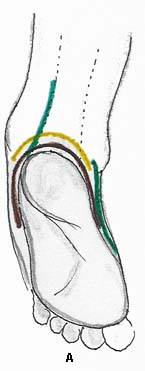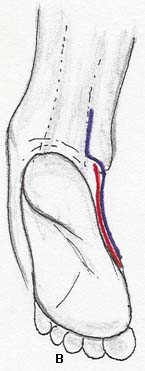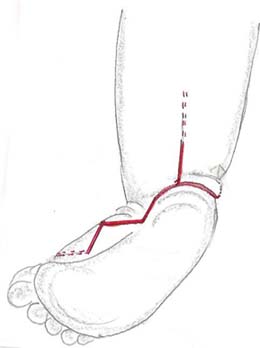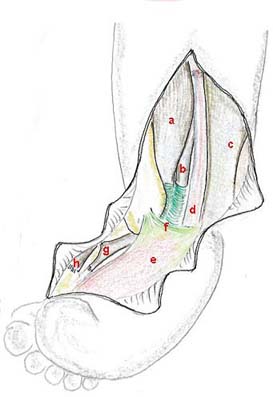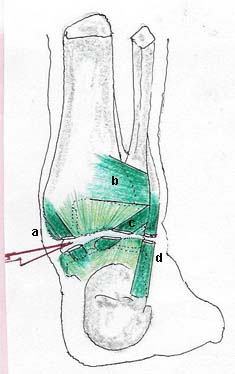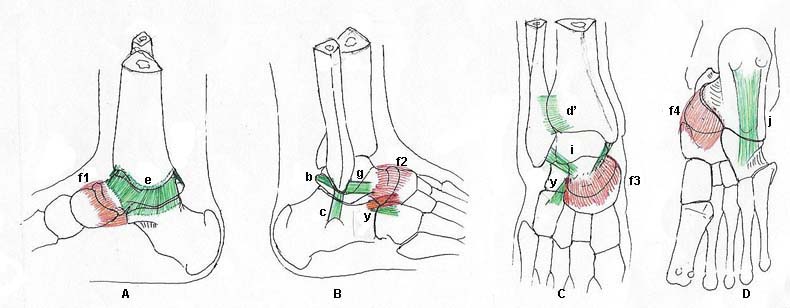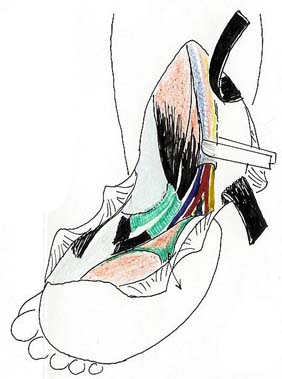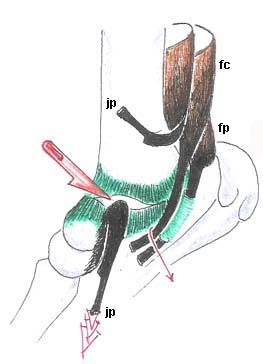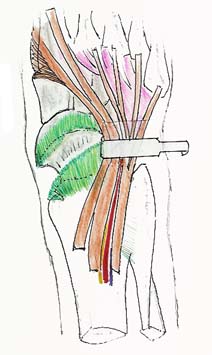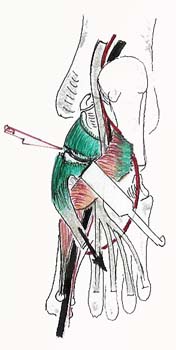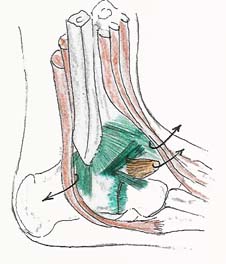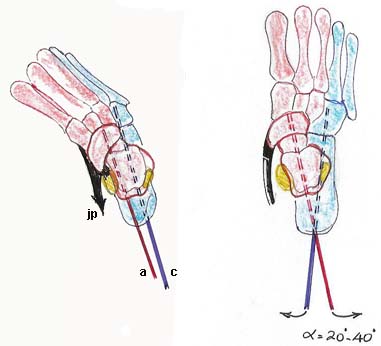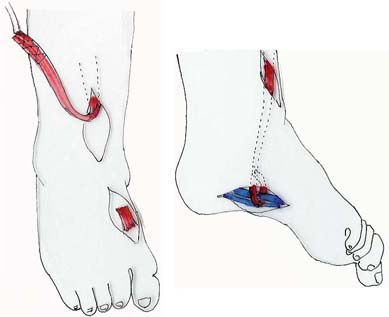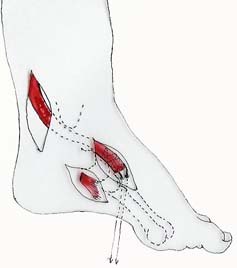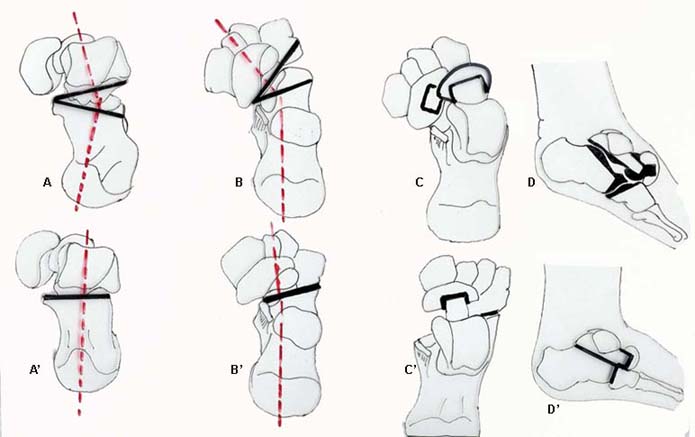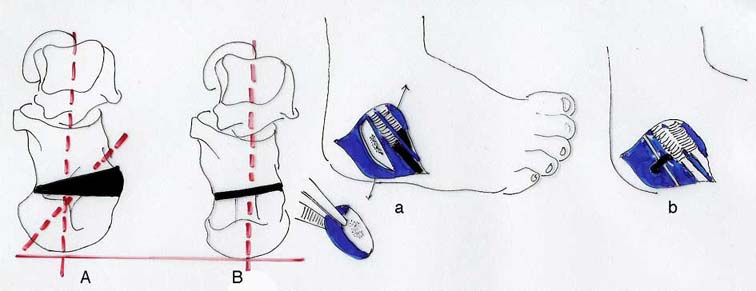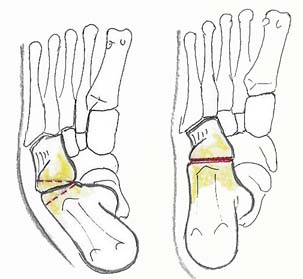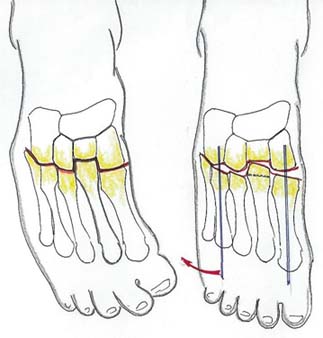01
Rappel Antomo-fonctionnel du Tarse
1. Le squelette du pied est construit autour de deux charnières
orientées perpendiculairement:
* la charnière transversale (fig.01) est l’articulation médio-tarsienne
de Chopart qui sépare:
- l'arrière-pied (arp) ou tarse postérieur, formé par
l'astragale (talus) et le calcanéum, de
- l'avant-pied (avp) formé par le scaphoide
ou naviculaire, les trois cunéiformes, le cuboïde, les cinq métatarsiens
& les phalanges .
* la charnière longitudinale , tracée de la berge médiale
du calcanéum au 3ème espace interdigital; subdivise le pied
en deux rayons :
|
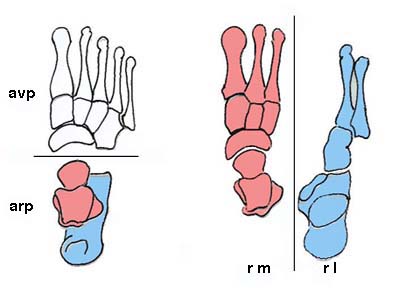
fig.01
|
- le rayon médial (r m),formé de l'astragale et du squelette
qui le prolonge en aval (scaphoide, cunéiformes, les trois premiers
métatarsiens), et
- le rayon latéral (r l) représenté-par le calcanéum et les
pièces annexes (cuboide, les deux derniers métatarsiens).
|
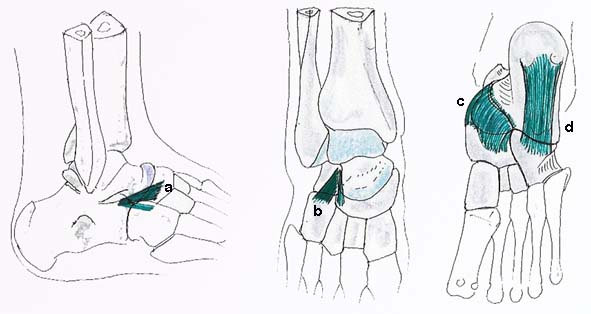 fig.02
fig.02
Les
deux rayons sont solidarisés à partir du calcanéum par deux paires de ligaments:
* Les ligaments dorsaux ont une insertion calcanéenne commune, sur une toute
petite aire contigüe au seuil du sinus du tarse, puis divergent en deux
faisceaux scaphoidien et cuboidien. Ce ligament en Y est remarquable
par l'orientation spatiale de ses deux composantes, le faisceau calcanéo-cuboidien
est étalé horizontalement alors que son homologue calcanéo-scaphoidien est
orienté sagittalement et entre ainsi dans la constitution de l''acetabulum
pedis'.
* Les insertions
des deux ligaments plantaires sont nettement distinctes. La charnière
médio-tarsienne est maintenue du côté latéral
par le ligament calcanéo-cuboidien (d); et par le ligament
calcanéo-scaphoidien du côté médial (c);
ce ligament est le principal soutien de la tête astragalienne, il
contribue ainsi à la constitution de l'acétabulum pedis.
Dépourvu
d'insertion musculaire, l'astragale ou talus est assimilable à une
grosse bille interposée entre la mortaise tibio--péronière et le reste
du tarse, entrant ainsi dans la mécanique des articulations adjacentes.
En flexion dorsale, il s'encastre dans la mortaise
et fait corps avec elle; autrement, il s'en libère quelque peu en position
d'équin et participe passivement aux mouvements de prosupination et de rotation.
Le calcanéum est mobilisable par rapport à l'astragale, activement en
flexion plantaire sous l'action du triceps. Les autres mouvements (flexion
dorsale, prosupination, rotation), nés dans l'avant-pied, lui sont transmis
par l'intermédiaire des ligaments qui l'unissent au scaphoide et au cuboide
et principalement par le complexe ligamentaire appelé ' acetabulum pedis '.
Le scaphoide (naviculaire) est situé au sommet de la voûte plantaire, sa
mobilisation par le jambier postérieur, le fait glisser en dedans et en haut
contre la tête de l'astragale.Le cuboïde est solidaire des déplacements du
calcanéum et du scaphoide.
02
La
musculature
Abstraction faite des muscles intrinsèques, le pied est équilibré
par le jeu de quatre groupes musculaires provenant du squelette sus-jacent.:
* le
triceps sural est le fléchisseur plantaire principal, son tendon (d'Achille)
se termine sur l'extrémité et la face médiale de la grosse tubérosité
du calcanéum, de sorte qu'à la flexion plantaire s'associe un certain
degré de supination qui équilibre le valgus physiologique du calcanéum.
* le groupe fléchisseur dorsal est représenté par les extenseurs propre
et commun.
* les deux muscles jambiers, antérieur et postérieur, constituent le
groupe supinateur, leurs tendons se terminent sur les piliers de la
voûte plantaire.
* les péroniers dont les tendons se terminent sur les bords médial &
latéral, constituent le groupe pronateur. |
 |
Si on considère
l'ensemble de cette musculature par rapport à l'articulation médio-tarsienne,
seul le triceps se termine en arrière de cette charnière, les trois autres
groupes sont insérés en aval, c'est la synergie de leur contraction qui équilibre
la puissante action du triceps.
Stabilisation
de l'astragale
La position et la morphologie de l'astragale - telle une bille, dépourvue de
toute insertion musculaire, intercalée entre mortaise et calcanéum - la prédisposent
à l'énucléation;une telle éventualité est contrecarrée par l'existence de formations
périphériques stabilisatrices:
Stabilisation
frontale
 |
Les
bras de la pince bimalléolaire (mt/mp) sont de dimensions nettement
inégales, la malléole tibiale (mt) est courte et massive ,découvrant
deux-tiers de la face médiale de l'astragale; mais ce déficit est
compensé par l'étendue et l'épaisseur du ligament deltoide (ld);
tandis que la malléole péronière (mp), plus longue, couvre toute
la hauteur du versant latéral, le ligament calcanéo-fibulaire (lcf)
qui la prolonge est relativement grêle. |
| |
Stabilisation
dans le sens sagittal
Le changement
de cap des tendons issus de la musculature jambière crée au
niveau malléolaire des lignes de forces dont la résultante tend
à luxer l'astragale en arrière.
La conformation du rebord postérieur de l'épiphyse tibiale qui se
comporte comme un buttoir (3° malléole de Destot), et le renforcement
de la capsule tibio-tarsienne postérieure par les ligaments talotibial
& talofibulaire empêchent tout mouvement de glissement postérieur. |
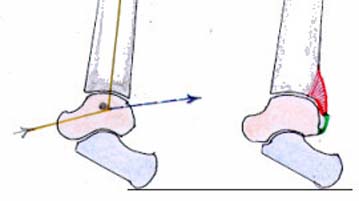
|
04
L'adaptation
de la poulie à la mortaise tibio-péronière
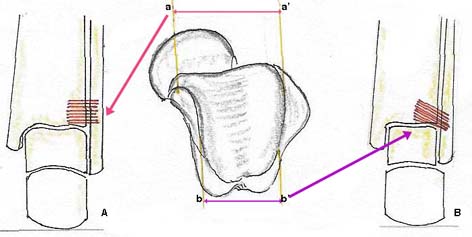
Lors des mouvements de flexion de la
cheville, la mortaise tibio-péronière s'adapte à la largeur de la
poulie astragalienne dont le versant postérieur (b b')est plus étroit.
Cette adaptation est liée à l'orientation des fibres des ligaments
tibiopéroniers distaux, dont le degré d'obliquité varie en fonction
de la largeur de la poulie. (A: en flexion dorsale; B: en flexion
plantaire).
L'attitude fixée en équin adapte la mortaise à la largeur de l
a portion postérieure de la poulie. |
05
La
voûte plantaire
La
position excentrée de l'atragale au dessus du calcanéum transforme
le rayon médial en une sorte d'arche dont seules les extrémités touchent
le sol (fig. de gauche). Il ne s'agit pas d'une simple
superposition de deux pièces osseuses comme le laisse supposer le
schéma du milieu (A), et dont on devine les hypothétiques défauts
- mauvaise répartition des lignes de force, écrasement de l'astragle,
affaissement - . |
|
En fait, le décalage antérieur de l'astragale (sch. de droite:
B) place la tête en porte-à-faux au sommet de la voûte plantaire,
transformant celle-ci en une structure souple et déformable. Une telle
architecture contribue à répartir harmonieusement le poids corporel
lors de l'appui unipodal, soulage l'astragale et augmente le bras de
levier calcanéen sur lequel agit le triceps. |
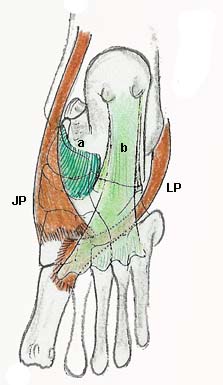 |
L'étendue et l'élasticité
des ligaments plantaires (a/b) constituent le principal facteur
de maintien de l'ogive plantaire qui est par ailleurs le carrefour
où convergent les tendons jambier postérieur (JP)et long péronie
(LP)r, qui se comportent comme des rênes imprimant à la plante des
mouvements d'inversion & d'éversion.
|
06
Le complexe 'acetabulaire'
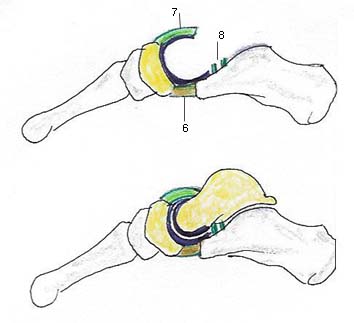
acétabulum en coupe sagittale |
L'articulation
talo-naviculaire fait intervenir un complexe ostéoarticulaire en forme
de cupule (acetabulum) dont la structure évoque une coiffe tapissée
de cartilage et à la constitution de laquelle participent:
* le ligament talonaviculaire
dorsal (7),
* la facette articulaire du naviculaire,
* le ligament calcanéo-naviculaire
plantaire (6),
* la facette talaire présinusale
(2') et
* le faisceau médial du ligament
en Y (5'). |
* Le
naviculaire - non représenté- se stuerait devant le talus dont la tête
repose sur le 'spring-ligament' (6) que renforce le faisceau médial
du ligament en Y(5& 5').
* Le ligament talocalcanéen, ou ligament en haie (8) est en fait un
porte-pédicule, qui véhicule les rameaux vasculaires sinusiens
destinés au talus, c'est l'ultime moyen d'irrigation de cette pièce
osseuse - dépourvue d'insertion musculaire - en cas de section
de la capsule tibio-tarsienne. |
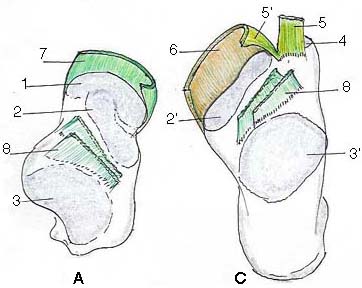
Désarticulation du
couple talo-calcanéen et retournement
de l'astragale.
|
Schématisation
de l'acétabulum à partir de ses composantes capsulaires:
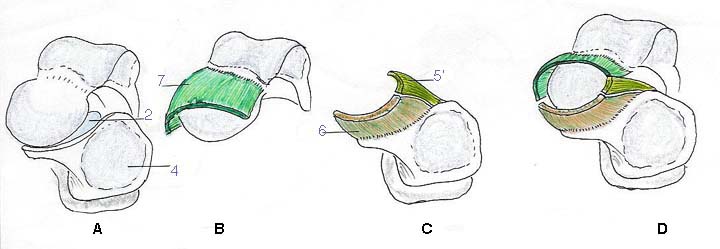
A- Vue antérieure
du couple talo-calcanéen, de la tubérosité antérieure du calcanéum dont la
face articulaire avec le cuboide (4) et la facette présinusale (2) sur laquelle
repose en partie la tête du talus.
B- le ligament talo-naviculaire (7);
C- le ligament calcanéo-naviculaire plantaire ou 'spring-ligament' (6),
et le faisceau médial (5') du ligament en Y.
La facette articulaire du naviculaire, en cupule, viendra s'inscrire dans
l'ouverture du manchon capsulaire reconstitué en D.
La réaxation du calcanéum n'est possible qu'après circumcision de ce manchon
capsulaire.
07
Mécanique
articulaire du tarse
|
 |
Dans
l'ensemble, le squelette du pied évoque un éventail dont l'extrémité
articulée est faite seulement de deux pièces, astragale et calcanéum,
diposées l'une au-dessus de l'autre, tandis que la partie élargie-
plurisegmentaire - s'étale progressivement jusqu'au contact des
orteils avec le sol.
L'étalement de l'avant-pied résulte de la divergence axiale du
couple astragale-calcanéum, angle dont l'amplitude est liée à la
rotation du calcanéum autour de son axe vertical.
L'astragale - encastré dans la mortaise tibio-péronière - ne participe
pas aux mouvements d'adduction & d'abduction 1. |
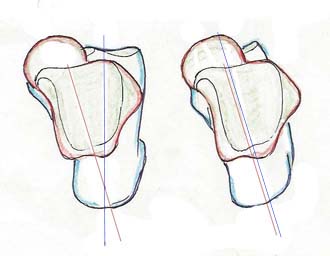 |
Le recours
à un jeu de pièces anatomiques démontables aidera à mieux saisir les effets
de la rotation du calcanéum sur l'orientation du talon et de l'avant-pied.
a-
On note après démontage et retournement de l'astragale (T), que le
couple talo-calcanéen (TC) s'articule à deux niveaux situés de part
et d'autre de la gouttière (d & d') du sinus du tarse: |
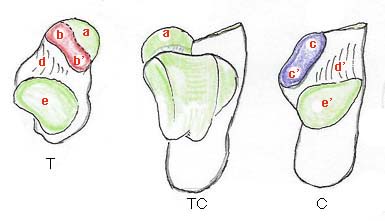 |
 |
La
conformation sphéroide des facettes postérieures (e-e') permet
au calcanéum de se mouvoir dans tous les sens.
Les facettes présinusales (b-b' & c-c'), inversement taillées, semblent
à première vue adaptables.
|
| En
observat le tarse postérieur en vue antéromédiale, on remarque
que les surfaces articulaires présinusales sont taillées dans des segments
de sphères de rayons inégaux, aussi, leur superposition ne portera à
aucun moment sur la totalité de leurs étendues, ce sera l'une ou l'autre
facette calcanéenne qui entrera en contact avec son homologue talienne,
et ce en fonction du sens de rotation du calcanéum. |
 |
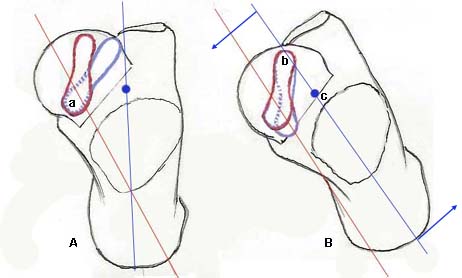 |
En
effet, si on remet les pièces en place et qu'on suppose l'astragale
- représenté seulement par la tête - transparent, on remarque qu'en
position neutre (A), ces facettes s'articulent au niveau de
leurs portions médiales (a) ; pour que leurs homologues latérales
(b) se superposent, il faut imprimer au calcanéum un mouvement d'adduction
(B) autour de son axe vertical (c) passant par le milieu de la gouttière
tarsienne. |

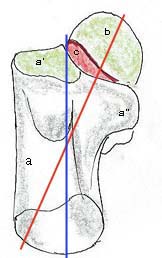
Fig 1
Calcanéum en abduction
La divergence axiale découvre la facette présinusale latérale
|
La
vue plantaire confirme ce fait, la superposition des facettes présinusales
latérales n'est possible qu'après rotation médiale du
calcanéum. |

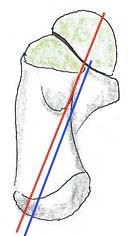
Fig 2
Calcanéum en adduction
L'angle de divergence est presque nul, la superposition des facettes
est maxima. |
b- La dénivelation
des facettes présinusales fait que sa mobilisation transversale s'accompagne
de son inclinaison frontale
en varus en valgus.
Quand on remet les pièces
en place et qu'on fasse glisser les facettes présinusales sous la tête de l'astragale,
on remarque que le mouvement d'adduction du calcanéum s'accompagne nécessairement
de son inclinaison en varus (fig2), comme le montre la déviation médiale de
l'axe vertical. Autrement dit, en se mettant en valgus (fig1), le calcanéum
présente sa facette médiale comme support à la tête de l'astragale, mais quand
il s'incline en varus (fig2), c'est la facette latérale qui entre en jeu laissant
à découvert le sustentaculum.
c
- La dernière conséquence de l'adduction calcanéenne est
l'éversion de l'avant-pied entrainé par la torsion des formations
ligamentaires unissant l 'extrémité antérieure du calcanéum au scaphoide
et au cuboide. |
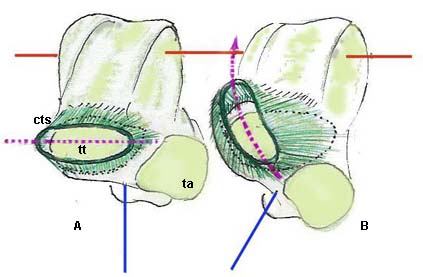
Le scaphoide, représenté par l'insertion du manchon capsulaire
de l'acétabulum, est entrainé par l'éversion du calcanéum, attitude
accentuée par la rétraction du Jambier postérieur. |
En conclusion:
| Durant
la marche, le pied porteur prend contact avec le sol par le talon, précisément
par la tubérosité postéro-larérale du calcanéum, auquel succède le rayon
latéral, puis le rayon médial dont l'arche module la répartion des forces
transmises par le poids du corps en appui unipodal. |
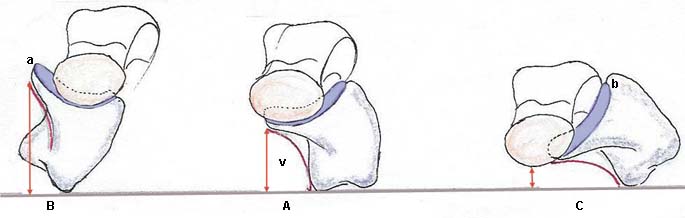
*
en phase d'équilibre (a), la tête de l'astragale repose sur le sustentacum
tali, laissant à découvert la facette présinusale latérale (f l)
du calcanéum,
* cette attitude s'exagère en position de valgus (c), la tête de
l'astragale pique vers le sol et comprime la voûte,
* ce processus de tassement est de courte
durée, très vite l'adduction du calcanéum rétablit la courbure
de l'arche en déplaçant latéralement le support de l'astragale.
Le varus (b) qui en résulte soulage efficacement la voûte plantaire.
.
|
Ce mouvement
"pendulaire" du calcanéum durant l'attitude érigée est initié
par les muscles jambiers et péroniers, toutefois sa modulation reste liée
à la souplesse et à l'élasticité des formations musculoligamentaires intrinsèques.
C'est la perte des qualités anatomiques et physiologiques de ce substratum qui
fixe ces déviations et les transforme en attitudes vicieuses telles qu'on les
observe dans le pied bot varus équin, le plat valgus, le talus, le pied convexe...
Aussi, la clé de toute intervention correctrice réside dans la réaxation anatomique
du calcanéum par rapport à l'astragale.
08
Expression
radiologique de la divergence axiale du tarse postérieur
1-
en vue de face:

|
|
L'angle
délimité par les axes longitudinaux reflète le degré de rotation du
calcanéum, il tend à s'annuler en position d'adduction maxima.
L'étendue du chevauchement des contours osseux permet d'apprécier
l'importance de cette divergence axiale. |
|
|
L'évaluation
radiologique de cet angle est un bon critère dans l'appréciation de
l'évolution du pied bot varus équin, les deux axes sont pratiquement
parallèles en position d'adduction du calcanéum.
L'exemple ci-contre montre le résultat orthopédique chez un enfant
revu six ans plus tard.
|
 |
 |
2-
en vue latérale:
L'adaptation des deux pièces maitresses est partielle en position d'adduction
du calcanéum, la béance du sinus du tarse sur les clichés de profil est l'expression
de cette attitude en cas de PBVE.
| Tarse
postérieure vue latérale, calcanéum en rotation neutre, chevauchement
astragalo-calcanéen. |
Calcanéum
en adduction maxima, dégagement des apophyse.
(noter l'épiphysite du scaphoide) |
L'équin trop
longtemps négligé adapte la mortaise aux dimensions du versant postérieur de
la poulie, moins large que l' antérieur dont l'hypertrophie est responsable
de l'équin résiduel chez le grand enfant; la correction de cette attitude nécessite
la création d'un diastasis par section de ces ligaments afin que l'astragale
puisse se mouvoir librement.
09
Le Traitement conservateur
a
pour objectifs l'assouplissement des articulations et le relâchement des
rétractions musculo-ligamentaires.
La mobilisation manuelle du squelette du pied est menée de façon passive, en
reprenant à l'envers les séquences ayant favorisé l'inversion, c'est à dire
qu'on commencera par 'dévérouiller' le bord médial rétracté autour du complexe
talo-calcanéo-naviculaire, avant de se préoccuper de l'équin.
La démarche à suivre est discutée avec le kinésithérapeute et expliquée à la
maman, nous nous servons à cet effet d'un moule plâtré sur lequel sont identifiés
les répères anatomiques qui guideront les manipulations.
Celles-ci comportent trois séquences:
* assouplissement du bord médial, concave. Combinaison de mouvements de redressement
et de plicature, en prenant appui sur les deux repères extrêmes: grosse tubérosité
du calcanéum & tête du 1° métatarsien. Le relâchement du tendon du
jambier postérieur est la clef du 'déverouillage' du complexe du tarse postérieur
et le glissement du scaphoide devant la tête de l'astragale;
* assouplissement du bord latéral, convexe: la torsion de l'avant-pied est redressée
par mouvement de levier, en exerçant un appui sur la tête du 1° méta et un contreappui
sur le cuboide;
* la troisième séquence consiste à mobiliser le calcanéum tenu entre pouce et
index autour de son axe longitudinal, jusqu'à pouvoir l'incliner progressivement
en valgus.
Ce n'est qu'après avoir avoir neutralisé le varus qu'on s'occupera de l'équin
en mobilisant le calcanéum - constamment tenu par le talon - dans le sens de
la flexion dorsale. Lors de cette dernière manoeuvre, l'avant-pied ne
servira aucun moment de bras de levier au risque au risque de créer un
pied convexe par dislocation de la médio-tarsienne.
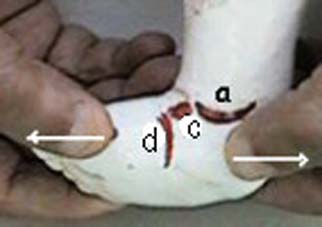
Séquence 1 |

Séquence 2 |

Séquence 3 |
La séance dure une vingtaine de minutes, une ou deux fois fois par semaine pendant
les six premiers mois, puis une fois par quinzaine les mois suivants; elle se
déroule de préférence après la tétée et en présence de la maman à qui on explique
la signification de ces manoeuvres, le cas échéant, on l'invite à
participer activement à ce programme.
Le
gain de correction obtenu à chaque séance est maintenu par un plâtre bien modelé
sur le talon et suffisamment rembourré au niveau de la gouttière du tarse, la
coloration des orteils et leur pouls capillaire sont vérifiés avant que l'enfant
ne quitte le lieu des soins.
10
La Cure Chirurgicale
consiste à
lever les entraves tendino-capsulaires qui maintiennent le pied en varus-équin
afin d'orienter anatomiquement le calcanéum et le scaphoide par rapport à l'astragale.
Les
Voies d'abord
|
Les
multiples voies d'abord se sont développées en fonction du site où
se situerait le principal défaut à l'origine des attitudes vicieuses.
a- l'incision médiale
classique (Bensahel) aborde directement la subluxation du scaphoide.
b-
l'abord
postéro-médial, prolongé le long du bord interne
du tendon d'achille permet de réduire l'équin.
c- l'abord mixte,
médial et latéro-achiléen, donne accès au versant articulaire latéral.
d- l'incision arciforme
allant de la base du 1° méta à la styloide du 5°, dite de Cincinnati,
expose tout l'étage sous-astragalien et permet de mobiliser aisément
le calcanéum. Elle peut se limiter au segment intermalléolaire (
mini-Cincinnati, e)
. |
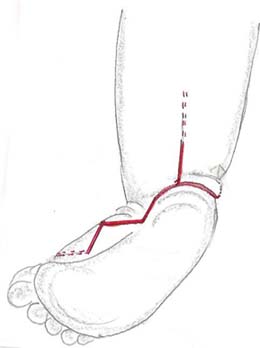
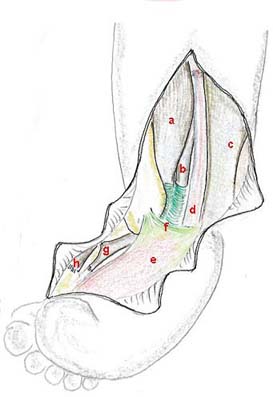
|
L'incision que
nous préconisonsons est de type postéro-médial,
transformable au besoin en incision arciforme, sa branche médiale
est tracée en zig-zag de manière à prévenir la rétraction cicatricielle.
|
11
Libération du Calcanéum / Temps tibio-tarsien postérieur
 |
L'allongement
du tendon d'Achille détend le triceps et libère le calcanéum dévié en
équin-varus. Quand il s'agit d'un équin résiduel isolé, l'allongement
distal est de mise, mais il serait sage de le pratiquer au niveau proximal,
à la jonction tendon-muscle, si on prévoit une intervention ultérieure
sur le tarse . L'allongement
est pratiqué en z inversé de manière à couper les faisceaux internes
qui s'insèrent sur la face médial de la grosse tubérosité et qui accentuent
le varus. La reconstitution du tendon est laissée en fin d'intervention. |
| L'ouverture
de la capsule postérieure est menée transversalement de façon à sectionner
les ligaments amarrant l'astragale aux malléoles: talotibial (a) et
talofibulaire (d) ainsi que le ligament calcanéo-fibulaire (c) bien
qu'il soit mieux individualisable lors de l'abord du versant latéral.
Le ligament tibiofibulaire postérieur (b) n'est entamé que chez le grand
enfant, le diastasis ainsi créé facilite la réintégration dans la mortaise
de la partie hypertrophiée de la poulie. |
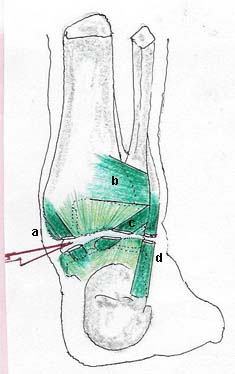 |
12
Libération du calcanéum / Abord postéro-médio-latéral
L'allongement
du tendon du jambier postérieur, celui du tendon d'Achille - s'il ne l'a pas
été auparavant la circumcision du manchon acetabulaire et la reposition du scaphoide
constituent les principales étapes de cette intervention. La schématisation
des différents versants du tarse répertorie les formations capsulo-ligamentaires
qu'on aura à identifier et à entamer:
*
L'aspect médial (A)comporte le puissant ligament deltoide, la section
doit porter sur ses deux composantes, superficielle (e) et profonde
( ligament talotibial).
* Le manchon de l'acétabulum pedis - en rouge - est abordé
et sectionné sur tout son pourtour ( f1,f2,f3,f4 ).
* Seuls les ligaments talo-fibulaire latéral ( g ) et calcanéo-cuboidien
( j ) ainsi que le faisceau cuboidien du ligament en Y sont conservés
intacts. |
Le versant médial
de la tibio-tarsienne est abordé à travers le canal tarsien dont le couvercle,
représenté par le muscle abducteur du gros orteil, est désinséré du calcanéum
et récliné en bas. On obtient ainsi un grand jour sur les formations qui masquent
l'articulation, ce sont le pédicule tibio-tarsien et ses terminales, les
tendons des muscles jambier postérieur et flechisseur commmun coulissant dans
leurs gaines, le tendon du flechisseur propre plus profond est caché par les
précédents.
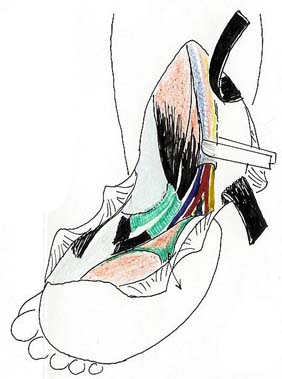
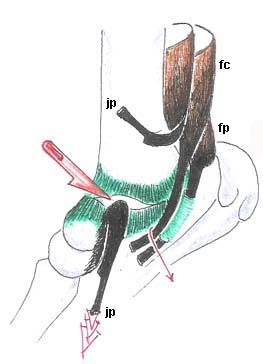
* Le pédicule
qu'on ne quitte pas des yeux, est chargé sur un lac.
* Ouverture des gaines et allongement du seul tendon Jambier postérieu
(jp)r, la mise en pronation du talon aide à sectionner le faisceau
profond du ligament deltoide et à prolonger l'arthrotomie tibio-tarsienne
jusqu'à rejoindre le plan postérieur déjà entamé.
*Les tractus fibreux, très serrés, qui soudent le tubercule scaphoidien
à la malléole tibiale sont coupés à la pointe de ciseaux fins,
* Le bout distal du Jambier postérieur constitue un précieux guide
qui mène à l'interligne talo-scaphoidien, point de départ de l'abord
acétabulaire.
|
13
Libération du Calcanéum / Abord du Complexe acetabulaire
Le
temps suivant, laborieux, s'attaque à l'acétabulum dont
le machon capsulaire sera sectionné sur tout son pourtour en commencant
par la face dorsale (a).
La manipulation des tendons extenseurs, jambier antérieur, du
muscle pédieux, et du pédicule tibial antérieur, permet de
progresser le plus en dehors possible.
|
On
revient au versant médial à partir duquel on entame la section du
'spring ligament' (b) composante plantaire de l'acétabulaum.
La traction sur le bout distal du JP aide à mobiliser le scaphoide
qu'on aura à disposer en fin d'intervention dans l'axe de la poulie
astragalienne.
* L'incision arciforme donne un garnd jour sur le versant latéral
du tarse (c). La capsule articulaire est en grande partie masquée
par les formations musculotendineuses, les tendons péroniers sont
plaqués contre la malléole latérale par une double gaine qu'il faudra
inciser afin de mettre en évidence le ligament calcanéo-fibulaire.
Les insertions d'origine du muscle pédieux sont ruginées et réclinées
pour découvrir le ligament en Y dont la section complète celle du
manchon acétabulaire. La section du ligament talofibulaire antérieur
n'est pas nécessaire. |
14
Reduction & contention
En fin d'intervention,
le calcanéum ne garde comme attache astragalienne que le ligament
en haie, porte vaisseau dont la texture n'est pas une entrave à
la réaxation. Ce dernier temps est facilité par la manipulation
de deux broches de Kirshner, trans calcanéo-cuboidienne (c) &
trans- talo-scaphoidien (a) après avoir réduit la luxation du scaphoide.
Leurs segments extériorisés - gardés assez longs - servent
comme leviers lors de la manipulation des deux rayons et comme moyen
de contention une fois enfouis dans le plâtre. On doit se contenter
d'un angle talo-calcanéen compris entre 20 & 40°.
Quant à l'équin, il sera corrigé manuellement et progressivement
lors des réfections de plâtre dès le 10°jour post-opératoire.
Les broches sont retirées deux mois plus tard; le plâtre est remplacé
par une attelle souple.
|
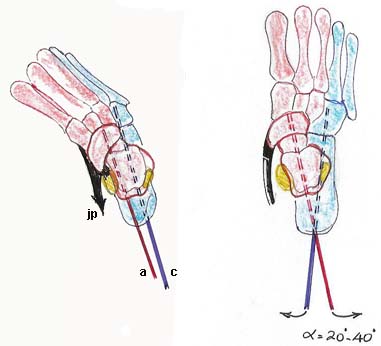 |
15
Transposition
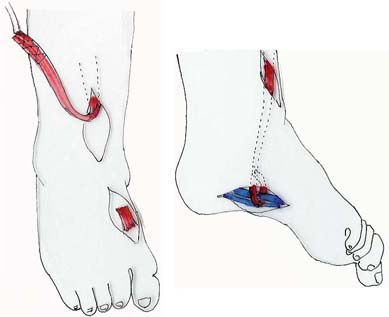 |
Jambier Antérieur
* Identification & désinsertion distale du tendon.
* La languette distale est réinséréesur la base de P1 pour éviter
le flexum du gros orteil.
* Extériorisation du bout proximal après laçage au crin.
* Tunnellisation latérale et solidarisation en lasso du J.A au tendon
du court péronier.
Immobilisation plâtrée pendant huit semaines.
|
Jambier Postérieur
* Identification du J.P par rapport au pédicule tibial postérieur à
travers une incision médioachiléenne,
* Abord de la voûte plantaire par une courte incision médiale,
* Section du tendon au niveau du tubercule scaphoidien,
* mobilisation du bout proximal lacé au crin vers le dos du 3° cunéiforme
qui transfixié et solidarisé au tendon. |
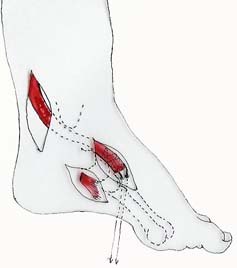 |
16
Triple arthrodèse
( type Lambrinudi )
Il
s'agit d'une intervention radicale, de remodelage et non d'équilibration,
permettant l'appui au sol d'un pied ayant perdu sa souplesse et sa
mobilité: aussi, ne doit-elle être envisagée qu'en dernier lieu, le
plus tard possible (entre 8 et 12 ans)..
|
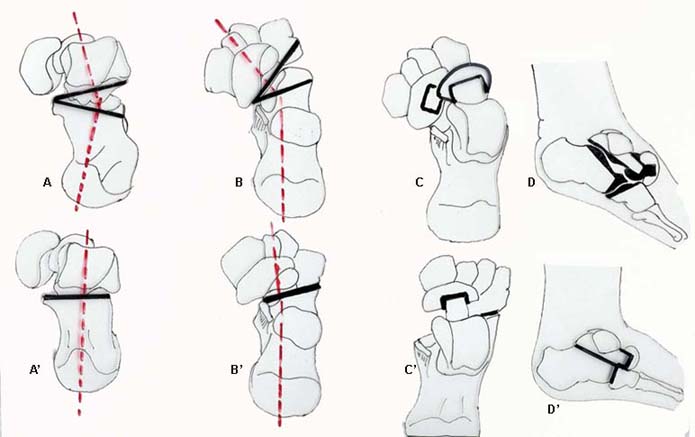
|
*
A1 & B1 : vue postérieure du tarse: ostéotomie talo-calcanéenne
cunéiforme à base latérale, emportant plus de tissu calcanéen de manière
à corriger le varus du talon.
* A2 & B2: vue supérieure du tarse sans talus: ostéotomie calcanéo-cuboidienne
à base latérale.
* A3 & B3 : vue supérieure du tarse: ostéotomie talo-naviculaire
en bilboquet.
* D: vue latérale du tarse réaxé. La correction est maintenue par
broches de Kirchner ou par agraffage et plâtre pendant huit semaines.
|
17
Ostéotomie de valgisation
*
L'ostéotomie calcanéenne de valgisation, décrite par Dwyer en 1963,
tente de corriger le varus résiduel de l'arrière-pied par ablation
d'un coin osseux longitudinal, à base externe, taillé sur la face
latérale du calcanéum. Le même résultat est obtenu par inclusion d'un
greffon à travers une ostéotomie médiale. Elle est d'exécution
simple, efficace et peu agressive. La stabilisation est assurée par
une agraffe de Blount.
|
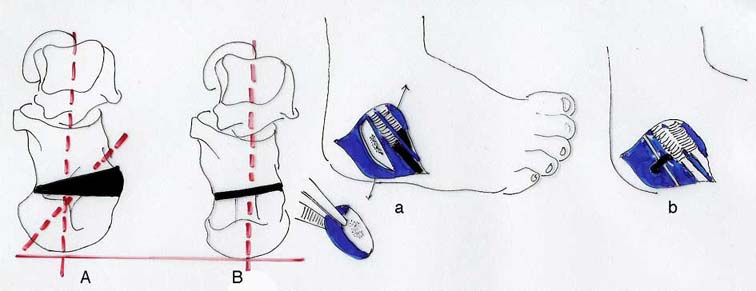 |
Le coin osseux
est taillé de façon juste afin de ne pas créer un pied plat valgus.
Cette intervention n'agit que sur le varus du talon, elle n'a
pas d'effet sur la convexité du latéral , ni sur l'équinisme ni sur
l'adductus de l'avant-pied. Il faut savoir que si ce dernier est prédominant,
le valgus obtenu par l'ostéotomie a tendance à s'accentuer par la
suite.
Son indication doit être large et envisagée à partir de l'âge de quatre
ans. |
18
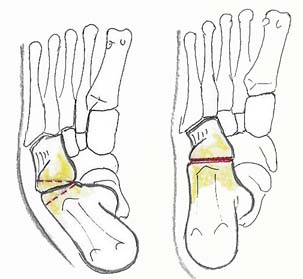 |
L'Ostéotomie calcanéo-cuboidienne
réduit l'angulation
du bord ateral du pied par ablation d'un coin osseux à cheval sur
le calcanéum et le cuboïde. Bien que ce soit une arthrodèse, son retentissement
sur la souplesse du pied est minime. Son intérêt réside dans le fait
qu'elle régularise le bord la-céral du pied tout en réduisant l'adductus
de l'avant-pied. Combinée à l'ostéotomie de Dwyer, elle permet de
remodeler correctement le pied dès l'âge de quatre ans et d'éviter
ainsi la triple arthrodèse. |
19
Arthrotomie
tarso-métatarsienne
Cette intervention
décrite en 1958 par Heyman a pour objet de corriger
l'adductus de l'avant-pied. Après section des faisceaux
dorsaux de l'articulation de Lisfranc et déviation de l'avant-pied
en dehors, la réaxation obtenue est maintenue par deux broches de
Kirchner. Toutefois, la correction est souvent minime en raison
de l'encastrement de la base du 2° méta qui limite la
béance médiale de l'interligne tarso-métatarsien.
La variante intoduite par Herndon consiste à ostéotomiser cette
base, ce qui rend l'interligne plus régulier, facilitant ainsi
la correction de l'adductus.
Son unique indication est l'adductus résiduel de l'avant pied, après
correction de l'inversion du tarse. Elle n'a pas d'effet sur l'adductus
compensateur d'une antéversion fémorale, d'une rotation tibiale ou
d'un valgus excessif du talon. Dans ce dernier cas, la correction
de l'adductus déséquilibre complètement l'appui.
Quand l'intervention est justifiée, on la pratique entre cinq et huit
ans. |
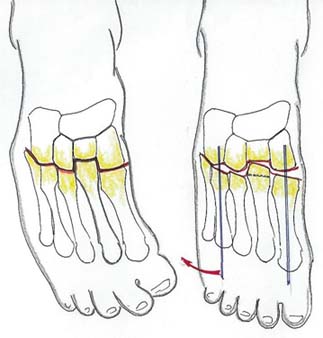 |
20
Tableau synoptique des procédés chirurgicaux
Procédés: |
Bensahel |
Caroll |
Mc
Kay |
Turco |
Simons |
|
Nature
du défaut initial |
Subluxation
naviculaire |
Rotation
latérale du talus |
Rotation
médiale du calcanéum |
Complexe
Talo-Calcanéo-naviculaire |
Talo-soustalus |
|
Niveau
abordé |
à
la carte |
médial
&postéro-latéral |
talo-calcanéen |
postéromédial |
Sous-tal.
|
|
Age d'intervention |
4
à 12mois |
2
à 6mois |
avant
9mois |
9
à 12mois |
4
à 6mois |
|
Incision |
médiale |
double(médio-lat) |
cincinnati |
médiale |
cincinnati |
|
Tendon
d'Achille |
Allongement |
Allongement |
Allongement |
Allongement |
Allongement |
|
Jambier
Postérieur |
si
nécessaire |
|
Flechiss.
Commun |
|
si
nécessaire |
|
Flechiss.
Propre |
|
solidarisé
au tendon d'achille |
transféré
sur le tendon du Long Peron.latéral |
|
si
nécessaire |
|
Abducteur
1° Orteil |
Désinséré
de son origine calcanéenne |
|
Fasciotomie
plantaire |
non |
si
nécessaire |
après
3ans |
si
nécessaire |
|
Muscle
Pédieux |
|
|
désinsére |
|
|
Procédés: |
Bensahel |
Caroll |
Mc
Kay |
Turco |
Simons |
|
Capsule
tibio-tarsienne post. |
|
incisée |
|
Capsule
talo-naviculaire |
incision
des versants medio-dorso-plantaire |
circumcision |
capsulotomie
médiale |
incision
des versants medio-dorso-post. |
|
Capsule
sous-talienne |
intacte |
incisée
en medio-postéro-latéral |
incisée
en medio-postéro-lat |
|
Capsule
calcanéo-cuboidienne |
|
incisée
en médio-latéral |
circumcision |
circumcision |
|
Capsule
navi-cunéiforme |
|
|
|
|
|
Capsule
cunéo-metat. |
|
|
|
si
nécessaire |
|
Procédés: |
Bensahel |
Caroll |
Mc
Kay |
Turco |
Simons |
|
Ligaments
talo-calc. |
conservés |
sectionnés |
sect.
latérale |
|
Ligt en
haie |
|
|
sect.partielle |
|
sect.totale
ou partielle |
|
Ligt deltoide |
|
section
de sa portion antérieure |
|
Spring-ligament |
|
sectionnés |
|
Ligt
en Y |
sectionné |
|
Ligt navi-cunéif |
désinseré |
|
désinsére |
|
désinséré |
|
Ligt
calcanéo-fibulaire |
|
sectionné |
|
Aponévrose
superf. & ligt annulaire latéraux |
|
incisés |
incisés |
|
incisés |
|
Embrochage
|
talo-calcan.
& talonaviculaire |
talonaviculaire |
talocalcanéen |
talonaviculaire
& calcanéo-cuboidien |
talonaviculaire
calcanéo-cuboidien & talonaviculaire |
Procédés: |
Bensahel |
Caroll |
Mc
Kay |
Turco |
Simons |
|
1°Platre |
Cruropdieux
pendant 4 semaines |
cruropedieux
le pied en rotation lat. / 3mois |
|
jambier
pendant
6 semaines puis 4 mois |
|
|
Ablation
broches |
8°
jour |
|
|
6°
semaine |
|
|
Attelle
Denis Browne |
|
|
|
nocture
pendant 12mois |
|
|
Contrôle
radiologique |
|
|
|
|
peropératoire |
|
Résultats
Bons |
88% |
82% |
80% |
83% |
|
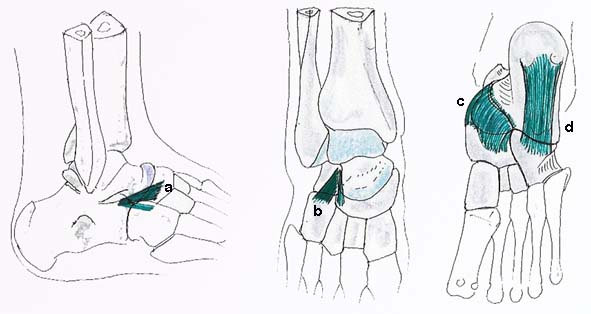 fig.02
fig.02