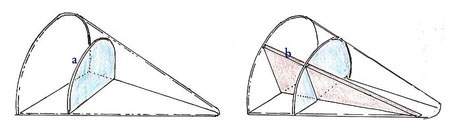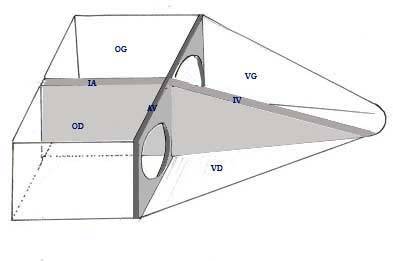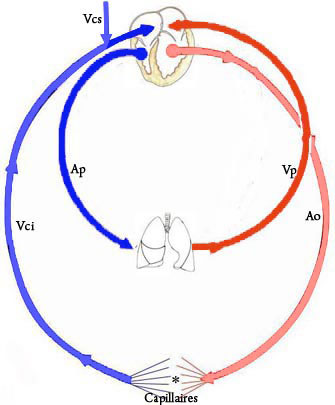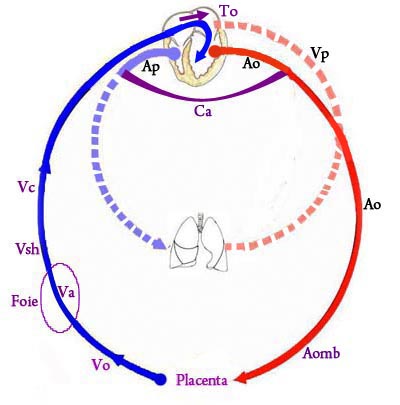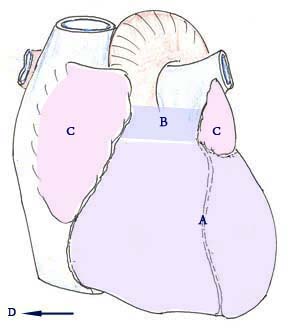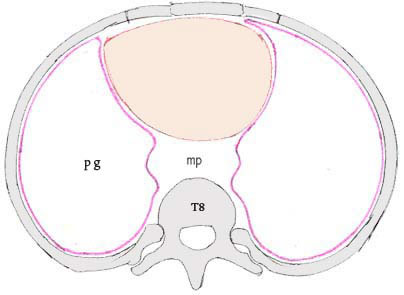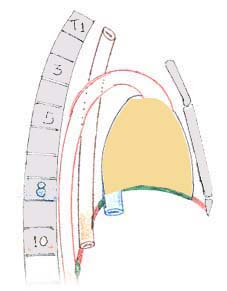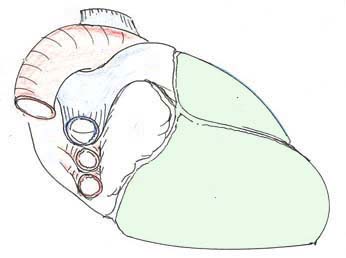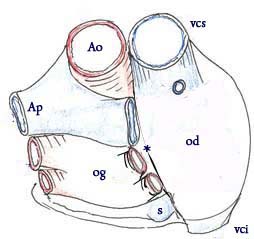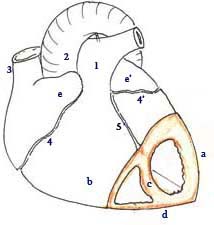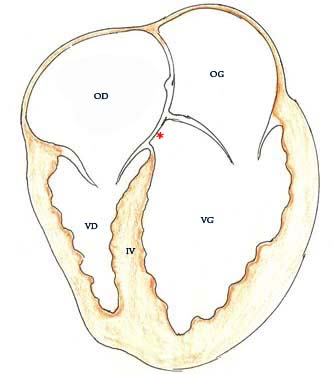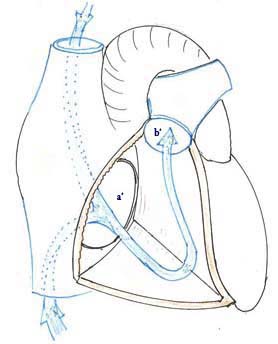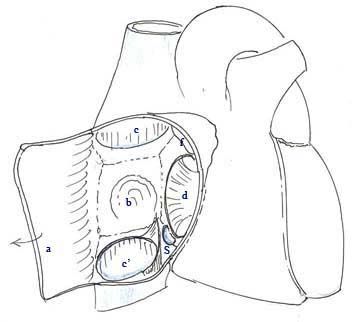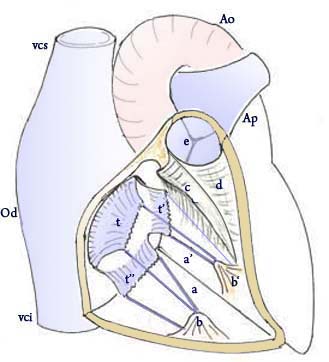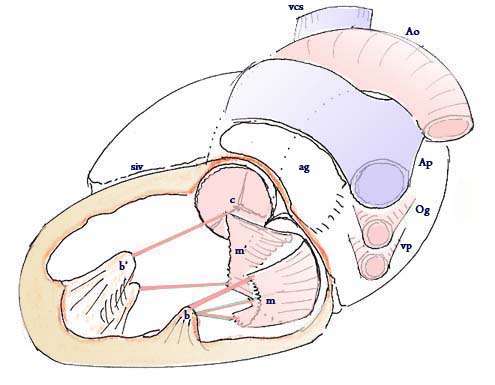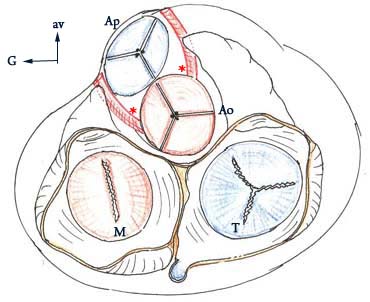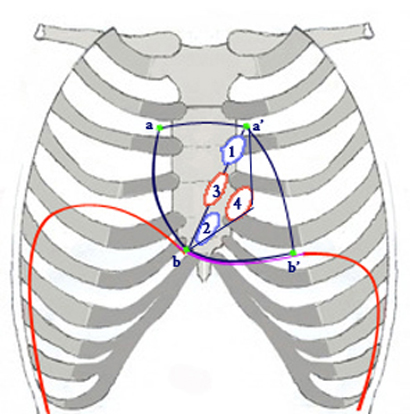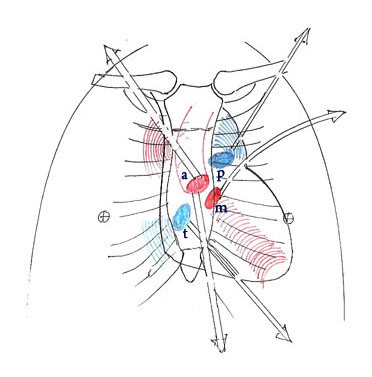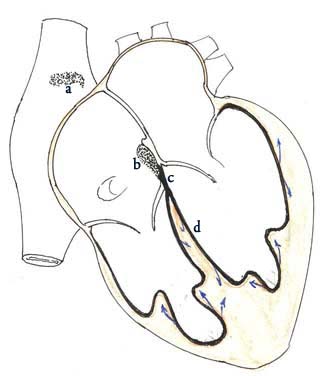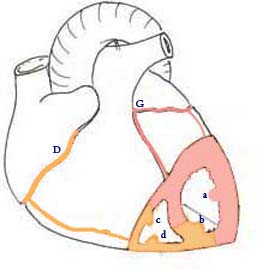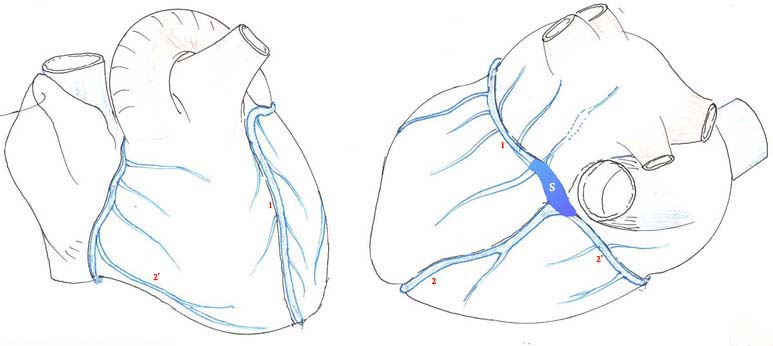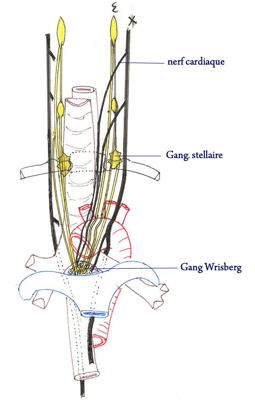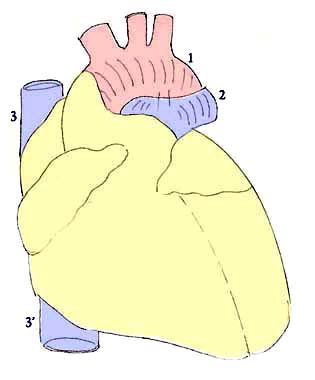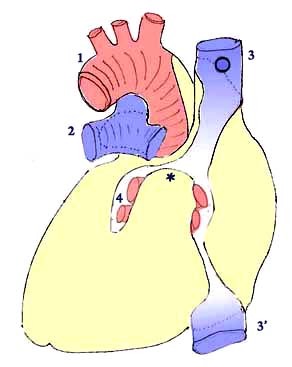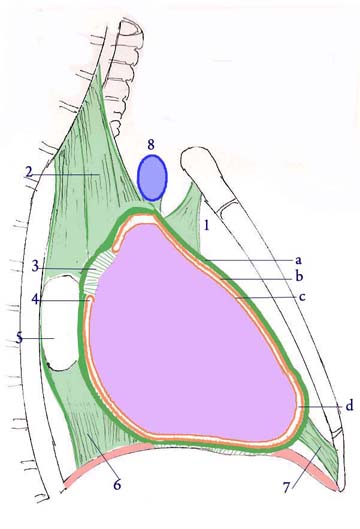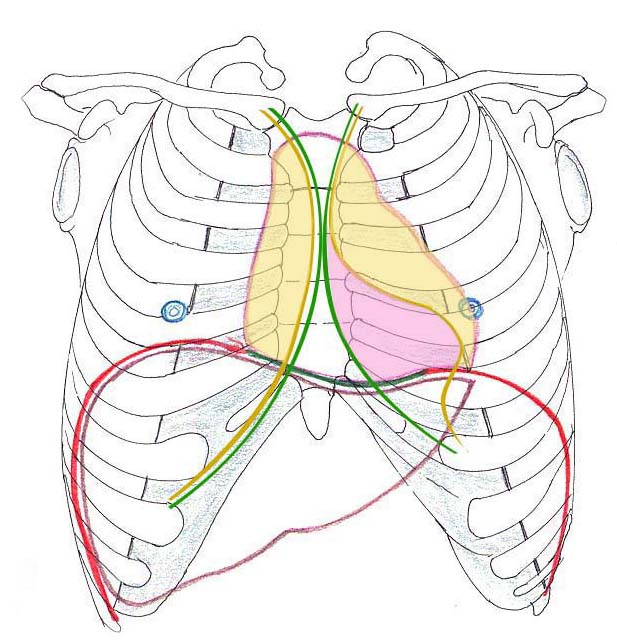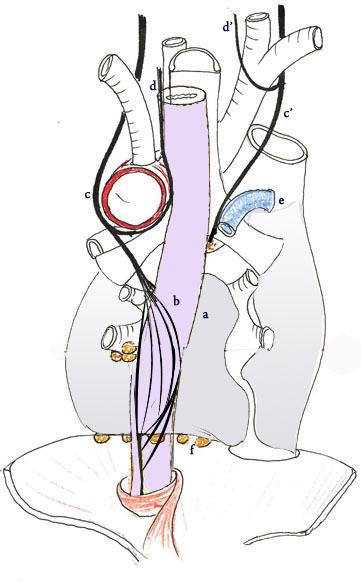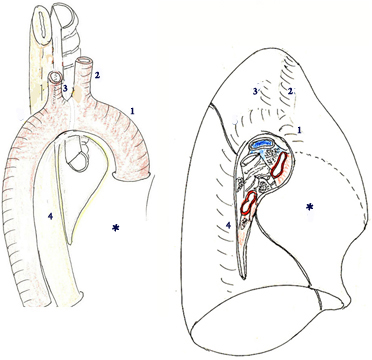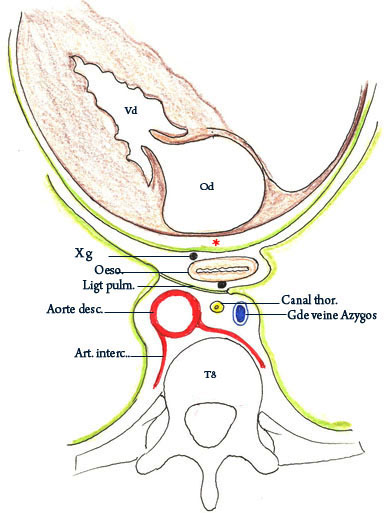Le CÏur
Le cÏur est un muscle creux dont la fonction est
le pompage du sang travers le rseau vasculaire irrigant les tissus de
lĠorganisme; ses phases de remplissage et de refoulement se droulent dĠune
faon rythmique.
Ses parois
musculaires sont formes par un tissu contractile spcial, le myocard
; elles sont revtues par des membranes isolantes, endocarde et picarde ;
lĠensemble est contenu dans un sac fibreux, le pricarde.
LĠactivit
rythmique de ce muscle, exprime par des phases de contraction (systole) et de
relchement (diastole) est lie la stimulation auto-entretenue par le systme
cardionecteur, tissu intrinsque fait dĠamas de cellules et de faisceaux
dissmins dans les parois des cavits cardiaques.
|
|
|
Ces dernires
sont au nombre de quatre, dtermines par lĠentrecroisement de deux
cloisons verticales :
- lĠune
est parallle lĠaxe longitudinal du cÏur (b), le subdivisant en deux
compartiments droit et gauche totalement isols lĠun de lĠautre ;
- lĠautre
cloison (a) est perpendiculaire cette dernire, crant au niveau chaque compartiment deux cavits, celle
du ct basal est lune oreillette ou atrium ;
celle du ct de la pointe est un ventricule.
- Oreillette
et ventricule communiquent par un orifice pourvu dĠune valvule, cĠest dire
dĠun systme mcanique permettant lĠcoulement du sang dans un sens unique, de
lĠoreillette vers le ventricule ; la valve du ct droit est dnomme tricuspide
( trois valvules), celle de gauche est
dite mitrale ( deux valvules).
La cloison sparant
les deux oreillettes est le septum inter-atrial, elle se prolonge par le septum
interventriculaire, plus pais, sparant les deux ventricules.
Schma
circulatoire
Il est utile de rappeler la signification des
termes affects aux troncs vasculaires mergeant de la base du cÏur :
|
La
qualit du sang aboutissant au cÏur est double : -
en traversant le parenchyme pulmonaire, ce sang est soumis des changes
gazeux (hmatose) qui lĠenrichissent
en oxygne extrait de lĠair inspir, il est ramen au cÏur gauche par les
veines pulmonaires (Vp) qui sĠouvrent dans
lĠoreillette gauche, passe dans le ventricule du mme ct dĠo il est
propuls vers les espaces intercellulaires par le rseau aortique (Ao).
Il
est donc vident que lĠtanchit de la cloison sparant les deux
compartiments cardiaques droit et gauche exclut tout mlange qualitatif. |
|
Ce schma
circulatoire comporte donc deux circuits, lĠun trajet court, celui de la
petite circulation (cercle aux tons foncs)
reliant le ventricule droit lĠoreillette gauche - via le poumon - par
lĠintermdiaire de lĠartre et des veines pulmonaires.
La grande circulation (cercle aux tons clairs),
est une longue voie reliant lĠoreillette droite au ventricule gauche - via les tissus
- par lĠintermdiaire des veines
caves et de lĠaorte.
|
Le
circuit fÏtal diffre de ce schma en raison de lĠexclusion du parenchyme
pulmonaire, non exploitable avant la naissance, la fonction dĠhmatose tant
assure par le placenta. Ce modle circulatoire suppose des amnagements
tablissant des communications inter atriale et
inter ventriculaire : Ces
canaux dĠexclusion du poumon ont pour consquence le mlange qualitatif du
sang durant la vie fÏtale ; ils rgressent durant les premiers jours de naissance,
ne subsisteront de leur brve existence que leurs reliquats fibreux
reprsents par le ligament artriel et la fosse ovale.
_____________________________________________ - Vp :
Veine pulmonaire / Vsh :
Veines sus-hpatiques / - Vo :
Veine ombilicale |
|
LĠaspect extrieur du cÏur voque une pyramide triangulaire
aux bords et pointe mousss, couche par une de ses faces sur le diaphragme,
la base tant postrieure et le sommet excentr gauche.
Le
cloisonnement intrieur se reflte en superficie par lĠentrecroisement de deux sillons,
un sillon transversal dit coronal entoure la masse cardiaque en marquant la
frontire oreillettes et ventricules; lĠautre sillon ‑ superposable au
grand axe du cÏur ‑ est lĠexpression du septum sparant les deux
compartiments droit et gauche, il est dcomposable en sillon
inter-ventriculaire et sillon inter atrial.
Le cÏur occupe
lĠtage infrieur du mdiastin antrieur, il repose sur le centre phrnique, entour
par les plvres mdiastines, la paroi antrieure du thorax et lĠaxe Ïsophagien.
- La face antrieure, convexe, est
applique contre la paroi sterno-costale, elle ÔregardeĠ vers lĠavant et
droite. On lui distingue trois segments :
-
lĠaire ventriculaire (A) qui constitue les deux
tiers de cette face,
-
le segment artriel (B)
correspond aux orifices de lĠaorte et de lĠartre
pulmonaire,
-
le segment des auricules (C)
droite et gauche, chambres dĠexpansion des oreillettes, embrassant lĠmergence
des troncs artriels.
|
|
|
- La face gauche est entirement ventriculaire, elle est au contact avec
le poumon gauche qu'elle dprime
|
|
|
- La face infrieure est diaphragmatique,
elle repose sur le centre phrnique auquel elle adhre intimement par
lĠintermdiaire du pricarde. DÔaspect ovalaire, elle est subdivise par
lĠentrecroisement des sillons inter-atrio-ventriculaires en aires auriculaire
et ventriculaire. La plus grande part de cette face est ventriculaire. LĠaire
auriculaire correspond la partie basse des oreillettes.
|
-
La base, nettement postrieure, est la surface la plus rduite, elle
est souleve par deux boursouflures spares par un sillon vertical (*)
latralis droite, elles correspondent aux parois postrieures des
oreillettes, celle de gauche (og), oriente transversalement est le confluent
des quatre veines pulmonaires, celle de droite, verticale (od) correspond
la confluence des veines caves suprieure et
infrieure ; le sillon atrio‑ventriculaire masqu en grande partie
par le sinus coronaire (s), carrefour des veines du myocarde. |
|
- La pointe du cÏur est nettement
excentre gauche, elle se projette au niveau du 6Ħ
espace intercostal, 8 cm du bord sternal.
Elle n'est pas entame par le sillon interventriculaire qui contourne le bord
droit en dedans dĠelle.
- Les auricules sont des prolongements
des cavits atriales, tales contre les flancs de lĠmergence des gros
vaisseaux. Ce sont des rservoirs dynamiques dont lĠlasticit amortit les
effets des ‑coups de pression sur les parois relativement fines des
oreillettes. LĠauricule droite est plus dveloppe, elle est en forme de
languette applique contre le flanc de lĠartre pulmonaire. Toutes deux
masquent les segments correspondants du sillon atrio‑ventriculaire.
Configuration
intrieure
|
-
Le segment interventriculaire est le plus dvelopp, cĠest une paisse
cloison, charnue et incurve en C
dont la convexit fait saillie dans le ventricule
droit. ___________________________________ a : paroi
gauche / b : paroi droite / c : cloison interventriculaire /
d : paroi infrieure
(diaphragmatique) e
& eĠ : auricules droit & gauche / |
|
Une
tranche de coupe horizontale du volume cardiaque permet de noter :
1
- la nette disproportion entre les cavits, principalement celles relies aux
poumons ; en effet, le ventricule droit et
lĠoreillette gauche sont plus rduits en volume que les deux autres annexes
la grande part de lĠorganisme, territoire bien plus tendu que celui du
parenchyme pulmonaire ;
2 - lĠimportante paisseur des parois
ventriculaires ;
3
- le refoulement latral de la cloison interventriculaire augmente la capacit
du ventricule gauche ;
4
- lĠpaisseur des parois de ce dernier reflte la force musculaire considrable
quĠil doit dvelopper en propulsant le sang de faon soutenue jusquĠaux confins
les plus tnus des tissus. CĠest moins le cas du ventricule droit dont lĠeffort
de propulsion vers le poumon est adapt un trajet nettement plus court.
|
5
- La cloison sparant les deux compartiments cardiaques est dĠpaisseur
ingale et de texture htrogne ; - la portion atriale est fibro‑musculaire,
sa minceur est accentue par la fossette ovale entirement fibreuse; - la portion interventriculaire
est musculaire, nettement plus paisse et refoule vers le vers ventricule
droit. - le segment intermdiaire (*), trs court, est une fine membrane
dpourvue de myocarde, elle est situe au carrefour les anneaux fibreux
orificiels. Ses extrmits servent de point dĠancrage aux anneaux auriculo‑ventriculaires,
le droit est fix lĠextrmit distale de cette cloison, tandis que la
fixation de lĠanneau gauche est plutt proximale, ce dcalage en hauteur
transforme ce segment membraneux en cloison interpose entre lĠoreillette
droite et le ventricule gauche.
Les
fibres musculaires proprement dites se rpartissent en deux contingents
de faisceaux, ventriculaire et atrial, indpendants lĠun de lĠautre, elles
sont tresses en corbeilles dont les ouvertures sont insres sur le pourtour
dĠanneaux fibreux.
|
|
6 - Autre consquence de lĠingalit des
ventricules est la disposition des orifices intra cavitaires. En effet, le plus
grand
volume du ventricule gauche permet aux orifices mitral et aortique dĠtre
disposs cte cte sur un mme plan
perpendiculaire
lĠaxe longitudinal des ventricules.
Il en est autrement du ventricule droit, dont le
volume, plus rduit transversalement, est dvelopp en hauteur, cĠest dire
que
ses deux orifices, pulmonaire et tricuspide sont placs lĠun au-dessus de
lĠautre.
7 - Le flot sanguin dcrit au sein de chaque
ventricule un trajet coud, en pingle cheveux : le sang provenant de
lĠoreillette
est aspir vers le fond du ventricule puis renvoy en sens inverse vers
lĠorifice artriel correspondant. Ainsi,
chaque
ventricule comporte une chambre de remplissage donnant sur une autre
appele chambre dĠjection ou de chasse.
Ces deux compartiments sont sur un mme plan au
niveau du ventricule gauche.
Du ct droit, le refoulement de la cloison
interventriculaire a eu pour effet de rduire transversalement la chambre de
Remplissage ; le dficit en largeur est
compens par le dveloppement en hauteur de la chambre de chasse. Il en rsulte
une
disposition
tage, la chambre de remplissage tant au-dessous de la chambre de
propulsion ; pour accder
cette
dernire,
le flot sanguin emprunte une sorte de rampe en forme dĠentonnoir (infundibulum);
la frontire entre les deux niveaux
est
reprsente principalement par lĠperon de Wolff, auvent dvelopp sur la
voussure de la cloison interventriculaire.
|
|
|
8 - Les parois des chambres de remplissage sont
hrisses de colonnes charnues, reliquats de la structure spongieuse du cÏur
embryonnaire ; elles sont de volume et dĠaspect
trs varis, certaines en forme de piliers donnant attache aux cordages
tracteurs des membranes valvulaires tricuspide et mitrale. Par contre, les
parois des chambres de chasse sont lisses, ce qui favorise la propulsion sans
turbulence du flot sanguin travers travers les orifices aortique et
pulmonaire.
LĠoreillette droite est le confluent du
sang veineux charg en CO2. Elle est plus spacieuse que la gauche.
On lui dcrit, tel un cube, six parois. La paroi latrale (a)
est incise le long du sillon terminal et rabattue vers lĠarrire.
|
-
La paroi suprieure est occupe par deux orifices, celui de la veine cave
suprieure (c) est derrire
lĠorifice de lĠauricule droite (f).
LĠorifice est large dĠune
vingtaine de mm de large, il est dpourvu de valvule. -
La paroi infrieure est occupe par les orifices de la veine cave infrieure (cĠ)
et du sinus coronaire (s). LĠorifice
cave est large dĠune trentaine de mm ; le repli de sa lvre antrieure porte
le nom de valvule dĠEustache, il sĠagit en fait dĠun simple paississement,
en croissant de lune, dont une extrmit se prolonge vers la fosse ovale. |
|
LĠorifice du
sinus coronaire (s), confluent du sang
veineux du myocarde, dbouche devant celui de la VCI,
juste en avant de lĠextension mdiale du limbe, tout prs de la cloison
inter-atriale. Large dĠune dizaine de mm, il est pourvu dĠune valve translucide
(= de Thbsius) insre
sur son bord antro-latral.
- La paroi
antrieure correspond lĠorifice
de la valvule tricuspide.
- La paroi
postrieure correspond la confluence des deux veines caves.
- La paroi
latrale est lisse jusquĠ la crte verticale marquant lĠentre de lĠauricule
droite, celle-ci est hrisse de minuscules crtes musculaires en dents de
peigne (=
aire pectine). Cette crte frontire est lĠquivalent du sillon
terminal auriculo-cave bien visible sur la paroi externe du cÏur.
LĠoreillette gauche
est le rceptacle du sang oxygn provenant des poumons ; elle est moins
spacieuse que la droite.
|
-
La paroi postrieure, lisse, est occupe en grande partie par les orifices des deux paires de veines pulmonaires. -
La zone antro-suprieure de la
cloison inter-atriale porte un repli semi-lunaire. -
Les parois suprieure et infrieure nĠont
rien de particulier. -
La paroi antrieure est occupe par lĠorifice de la valvule mitrale. -
LĠauricule droite, plus rduite que la droite, sĠouvre dans la paroi latrale
ou gauche par un orifice ovalaire vertical |
|
La cavit du ventricule droit est prismatique, trois parois antrieure ou
droite, infrieure (a) ou postrieure et septale (aĠ) ;
la
base est occupe par lĠostium atrio-ventriculaire droit ; son grand axe
est orient vers la pointe du cÏur, formant avec
celui
de lĠoreillette un angle dĠune cinquantaine de degrs.
Les
parois de la chambre de remplissage sont hrisses de piliers musculaires
(b/bĠ) donnant attache aux filaments tracteurs (cordages)
des trois valves tricuspides. LĠorientation de ces membranes valvulaires
correspond celle des parois.
-
La paroi infrieure est celle de la chambre de remplissage ; elle est
lgrement concave et moins paisse (une demi-douzaine
de mm), -
La paroi antrieure ou droite est celle de la face sterno-costale du cÏur,
elle est hrisse de reliefs musculaires de moins en moins pais. -
La base est occupe par deux orifices valvuls, trs dcals en hauteur:
lĠostium de la valvule
tricuspide est celui de la chambre de remplissage, il en occupe la base, donc
il est plus droite et un niveau plus bas que lĠostium de lĠartre
pulmonaire ; celui-ci est haut situ lĠextrmit de lĠinfundibulum et
plus gauche. |
|
La
valve tricuspide comporte donc trois valvules ou cuspides orientes
selon les trois parois du ventricule : lĠantrieure (t) est la plus large,
la postrieure (tĠ) est festonne et la septale (tĠĠ), Les cordages sĠattachent
sur leurs faces paritales.
LĠorifice
tricuspide est plus large que celui de la mitrale.
Le ventricule gauche est en forme de cne
aplati, il reoit le sang satur en oxygne. LĠimportante masse musculaire de
ses parois lui permet de dvelopper une puissance de propulsion assurant une
pression de perfusion tissulaire pouvant atteindre 100mm Hg.
|
-
La paroi gauche ou latrale se continue sans dmarcation avec un court
segment de la paroi diaphragmatique. La paroi mdiale est septale, elle est
excave. -
La base est occupe par deux ostiums disposs sur le mme plan et cte
cte, celui de lĠaorte (c) est contre la cloison interventriculaire, celui de
la valvule mitrale est plac sa gauche. Les parois de la chambre de
remplissage sont hrisses de
volumineux piliers charnus (b/bĠ) sur lesquels sont fixs les cordages amarrs aux deux
cuspides mitrales, la grande (mĠ) est situe du ct inter-ventriculaire,
elle constitue par son tendue une sorte de voile interpos entre les deux
chambres artrielles : la chambre de remplissage est dans le
prolongement de lĠorifice mitral, tandis que la chambre de chasse sĠvacue
par lĠostium aortique. |
|
La valve mitrale ou bicuspide est deux valvules, une grande cuspide
antrieure, du ct septal, dĠaspect triangulaire et de texture lisse ;
lĠautre cuspide est postrieure festonne. Les cordages tracteurs relient les
bords libres aux deux grands piliers.
LĠappareil
valvulaire
Les deux valves
tricuspide et mitrale sont fixes chacune sur un anneau fibreux inextensible et
non contractile, elles sont pourvues de valvules dont lĠouverture est oriente
vers le ventricule. Par contre, lĠouverture et la fermeture des ostiums
aortique et pulmonaire sont contrles par des replis membraneux (valvules
sigmodes) dvelopps la racine de chaque tronc.
LĠablation des oreillettes
aprs section de la base
du cÏur permet de prciser leur disposition :
|
|
|
Les
orifices auriculo‑ventriculaires (tricuspide et mitral),
sont disposs transversalement et
relativement carts lĠun de lĠautre en raison de l'encastrement de
lĠostium aortique. Leurs valves sont mobilisables dans le sens ventriculaire.
LĠaire
de projection du volume cardiaque sur la paroi sterno costale est un quadrilatre
dont lĠtendue et lĠaspect varient avec la conformation du tronc et la position
du sujet. Elle est dlimite par le trac de quatre lignes lgrement convexes
vers lĠextrieur :
|
-
en haut, une ligne transversale situe dans les 2Ħ
espaces intercostaux, ses extrmits a
et aĠ sont situes 1,5
cm du bord correspondant du sternum ; -
en bas, une seconde ligne transversale lgrement incline vers la gauche qui
rase la jonction xipho-sternale ; son extrmit droite (b)
se situe sous la 6Ħ
articulation chondro-costale ; lĠextrmit gauche (bĠ)
est dans le 5Ħ
espace intercostal, quatre travers de doigt du bord sternal correspondant. - Latralement, lĠaire est comprise
entre les deux verticales ab et aĠbĠ. A
noter que les deux tiers de cette aire se trouvent gauche de la ligne medio
sternale, recouvrant ainsi les 3Ħ,4Ħ et 5Ħ
cartilages costaux, les extrmits antrieures des espaces inter chondraux
correspondants, ainsi que les trois quarts infrieurs du corps sternal. La
projection de cette aire sur le rachis dorsal occupe en hauteur quatre
vertbres, de la 5Ħ la 8Ħ. La
projection des orifices cardiaque occupe une aire triangulaire dont la base
correspond la diagonale aĠ-b ;
les orifices du cÏur droit, pulmonaire et tricuspide occupent les sommets (1)
et (2) ; tandis que
les orifices du cÏur gauche, aortique (3)
et mitral (4) en forment la
bissectrice. |
|
La projection
des orifices sur cette aire prcordiale est explorable par lĠauscultation. Les
orifices auriculo-ventriculaires en occupent la partie moyenne et la pointe du
cÏur, ce qui correspond la portion situe au-dessous et en dedans du mamelon.
Les orifices artriels occupent la base du cÏur, elle rpond la portion
suprieure de lĠaire pr cordiale comprise entre lĠextrmit sternale du 2Ħ EIC
gauche et celle du 2Ħ espace droit.
Les foyers
dĠauscultation du cÏur sont
des zones de la paroi thoracique antrieure o les bruits du cÏur sont
perus avec le
maximum de nettet. Ces derniers sont
lĠexpression auditive du claquement que produit la fermeture des cuspides.
-
Le premier bruit annonce le dbut de la
systole ventriculaire, il correspond la fermeture des valvules auriculo‑ventriculaires,
il s'entend avec le maximum dĠintensit la pointe du cÏur, dans le 5Ħ
EIC gauche, sous le mamelon.
-
Le deuxime bruit se place la fin de la
systole ventriculaire, il correspond la fermeture des cuspides semi‑lunaires,
il s'entend avec nettet la base du
cÏur au niveau du 2Ħ EIC
de chaque ct du sternum.
|
Les bruits anormaux, comme les
souffles, causs par un rtrcissement ou une insuffisance orificiels se propagent
selon une direction bien dtermine et constante, et bien distincte de la
projection des orifices. : -
Le foyer mitral se situe la pointe du cÏur dans le 5Ħ
EIC ; les souffles mitraux se propagent
vers le creux axillaire gauche ; -
le foyer tricuspidien est au niveau de lĠextrmit sternale du 6Ħ
cartilage costal ; les souffles lis cet orifice se propagent en bas
et gauche ; -
le foyer aortique est situ dans le
2Ħ espace intercostal droit, contre le
bord sternal, les souffles aortiques dus une insuffisance se propagent en
bas, ceux dĠun rtrcissement vers la clavicule droite ; -
le foyer pulmonaire est au bord sternal du 2Ħ EIC
gauche, les souffles de lĠorifice pulmonaire se propagent en haut et gauche. |
|
Le tissu cardionecteur
Le muscle
cardiaque est fait de deux sortes de tissus, le myocarde proprement dit dont la
contraction est la fonction primordiale ; et un tissu myocardique suffisamment
modifi dans sa structure pour avoir une fonction dĠexcitabilit et de
conductibilit, gnratrices de la contraction cardiaque.
I1 s'agit dĠune
structure faite dĠamas cellulaires et de faisceaux dissmins dars lĠpaisseur
des parois du cÏur. Elles sont organises en deux formations bien
distinctes : le nÏud sinusal ou sino‑auriculaire
(= SA / nÏud de Keith et Flack) est le stimulateur cardiaque, il appartient
exclusivement lĠoreillette droite; lĠautre nÏud est ventriculaire, il
est fait dĠun amas compacte (=
nÏud dĠAshoff‑Tawara) prolong par le faisceau de His
auquel fait suite deux branches intra septales qui s'panouissent en une trame
de fibres parpilles sous lĠendocarde.
|
|
|
Ne dans le
nÏud sinusal, la pulsation cardiaque se propage aux oreillettes, franchit
lentement la jonction auriculo-ventriculaire puis irradie grande vitesse dans
la masse ventriculaire. LĠlectrocardiographe enregistre la propagation de
lĠonde dĠexcitation tout au long de son trajet. CĠest grce cet
enregistrement qu'on identifie la contraction atriale, inaudible, par lĠonde P,
tandis que la contraction ventriculaire, bien audible, se traduit par le
complexe QRST.
Ainsi le nÏud SA
est le stimulateur naturel du cÏur, il provoque chaque contraction tout en
dterminant son rythme dit sinusal. Or, celui-ci peut changer sous lĠinfluence
du systme nerveux autonome ou de certaines hormones, (principalement
lĠphdrine et la thyroxine).
Vascularisation du
cÏur
Le myocarde et
ses enveloppes pricardiques sont irrigus par un riche rseau artriel et
veineux qui lui est propre, reprsent par les ramifications des artres
coronaires et les affluents du sinus coronaire. La principale particularit de
ce rseau est sa distribution territoriale bien dfinie et terminale.
Les deux artres coronaires sont les premires
branches collatrales de lĠaorte. Leurs points dĠmergence se situent au
niveau
de la dilatation qui marque lĠorigine de lĠaorte dnomme bulbe aortique (=
sinus de Valsalva), juste au‑dessus des
cuspides
semi‑lunaires gauche et droite.
Chaque artre coronaire chemine dans le sillon
auriculo‑ventriculaire correspondant aprs avoir contourn lĠmergence du
tronc
de lĠartre pulmonaire. Ce trajet initial est en grande partie masqu par les
auricules.
LĠartre coronaire gauche
(1) sĠinsinue entre le tronc de lĠartre
pulmonaire et lĠauricule gauche qui masque son court segment
initial
(1-2cm). Aussitt arrive au niveau du sillon
atrio-ventriculaire, elle se scinde en deux branches terminales:
-
LĠartre inter ventriculaire antrieure
(1a) (=
descendante antrieure gauche) suit le sillon homologue jusqu' son
prolongement sur la face diaphragmatique (1c).
Elle irrigue un large territoire gauche : presque la totalit de lĠoreillette, le ventricule, la cloison inter ventriculaire et les faisceaux
cardionecteurs atrio-ventriculaires. Elle se distribue principalement
lĠpicarde tout en envoyant des rameaux dans le septum.
Elle
fournit dĠautre part des collatrales obliques pour la paroi latrale du mme
ventricule.
-
LĠartre circonflexe
(1b) se dtache angle droit du tronc de la
coronaire, contourne le bord gauche du cÏur, passe sur la face postrieure o
elle sĠanastomose avec la
coronaire droite. Son segment initial est tout prs de lĠanneau dĠinsertion de
la valvule mitrale. Elle fournit avant de contourner le bord gauche lĠartre
marginale (1d) qui chemine vers la
pointe du cÏur, elle irrigue la
paroi postro-latrale du ventricule gauche.
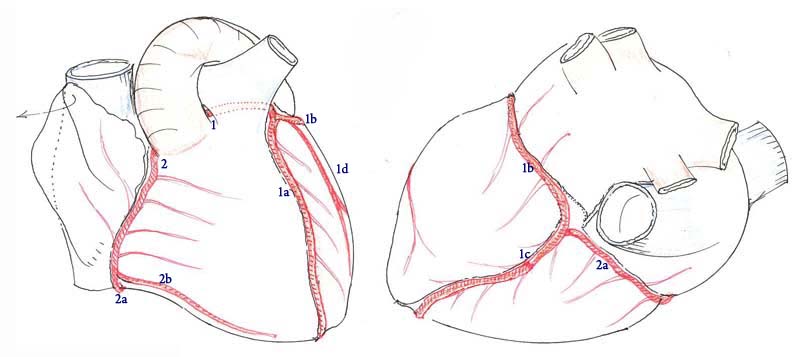
LĠartre
coronaire droite (2) merge du sinus aortique homolatral, sĠinsinue entre
lĠauricule droite et le tronc de lĠartre pulmonaire, passe dans le sillon AV
droit antrieur, puis son prolongement postrieur aprs avoir contourn le bord
infrieur du cÏur, arrive mi-chemin, au niveau de lĠintersection des sillons
IA et IV postrieurs, elle se divise en deux
branches :
- lĠartre transverse (2a),
court segment qui sĠanastomose avec lĠartre circonflexe gauche; et
- lĠartre IV
infrieure ou postrieure (1c) qui fusionne avec son
homologue ne de la coronaire gauche.
-
Auparavant, ds son mergence du bulbe aortique elle donne sa premire
branche collatrale, lĠartre du
nÏud sinusal. Elle fournit par ailleurs avant
de passe sur la face diaphragmatique lĠartre du bord droit (2b)
|
Dans
lĠensemble, la coronaire gauche irrigue la moiti antrieure de la
cloison interventriculaire et la paroi adjacente du ventricule droit ainsi
que sa paroi antrieure, le bord gauche, le piler antrieur (a)
et une partie rduite de la paroi infrieure du ventricule gauche. Le
territoire irrigu par la coronaire droite comprend le reste des
parois du ventricule droit, la moiti postrieure du septum interventriculaire,
les piliers antrieur et postrieur (c/d)
droits ainsi que le muscle papillaire postro-mdial du ventricule gauche (b). |
|
Il existe un
riche rseau dĠanastomoses entre les petites branches terminales des coronaires
doite et gauche, il est exceptionnel dĠen observer entre les principales collatrales.
Le drainage veineux est assur par les affluents
du sinus coronaire. Celui-ci (s) est un petit sac veineux ovalaire dĠune
vingtaine
de mm de long, insr transversalement dans lĠintersection des sillons inter
atrial et inter ventriculaire.
Son extrmit gauche reoit la grande veine
cardiaque (1), lĠautre extrmit est
lĠaboutissement de la veine moyenne (2)
et
de la petite veine (2Ġ) cardiaques. Il se dverse
directement dans lĠoreillette droite,
par un orifice situ entre la VCI
et
la
valvule tricuspide.
|
|
-
La grande veine est le principal
confluent drainant le sang veineux des territoires irrigus par lĠartre
coronaire gauche ; elle sĠindividualise la pointe du cÏur, accompagne
lĠartre le long du sillon IV antrieur, contourne
le bord gauche en direction du sinus veineux.
Les deux autres veines drainent le sang du territoire de la coronaire
droite.
-
La veine moyenne se constitue au niveau
de la pointe, passe dans le sillon IV
postrieur en compagnie de lĠartre, elle aboutit la corne droite du sinus
coronaire.
- La
petite veine accompagne la branche
marginale de lĠartre coronaire droite ; elle se vide inconstamment
dans le sinus ou directement dans lĠoreillette
droite, comme cĠest le cas de quelques veines thbesiennes et
superficielles.
Les
lymphatiques issus du myocarde se drainent par deux
collecteurs antrieur et postrieur qui
aboutissent aux ganglions tracho‑bronchiques.
|
Les
nerfs cardiaques sont reprsents par des rameaux neuro‑vgtatifs
provenant des chaines sympathiques cervicales et des deux pneumogastriques. -
Chaque nerf vague fournit trois contingents de nerfs cardiaques. Les rameaux
suprieurs proviennent de son segment cervical, les nerfs intermdiaires
naissent aprs lĠmergence des rcurrents ; les nerfs infrieurs, trs
courts, se dtachent en plein mdiastin suprieur. -
Les nerfs provenant du sympathique sont au nombre de trois de chaque ct,
issu chacun dĠun ganglion cervical. Toutes
ces fibres, dont la disposition est trs variable, s'enchevtrent autour et
sous la crosse de lĠaorte, se mlangent
avec des ganglions, lĠensemble forme le plexus cardiaque (de
Wrisberg) qui occupe lĠespace interbifurcal ; de
l partent les filets nerveux destins aux ganglions cardiaques intra muraux.
On admet que les rameaux issus des nerfs droits contrleraient le nÏud sinu-atrial, et
que les gauches influenceraient le nÏud auriculo‑ventriculaire. |
|
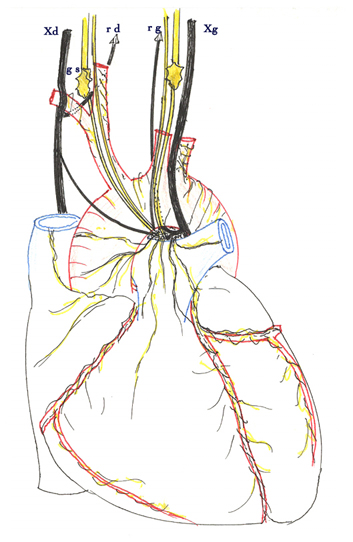 |
_________________________________________________ Le tronc de l'artre pulmonaire est sectionn ras de son ostium, |
a & b: plexus cardiaques profond & superficiel / c: ligament artriel
/ ap: ostium de l'artre pulmonaire / cd & cg: artres coronaires droite
& gauche / gs: ganglion stellaire / rd & rg: neerfs rcurrents droit & gauche / sv: sinus de Valsalva / X nerf vague |
Le Pricarde
Est un sac
fibro-sreux, double paroi, recouvrant le cÏur et lĠorigine des gros
vaisseaux qui sĠen dtachent.
Il
a la forme dĠun cne creux, adhrant par sa base au diaphragme et aux gros
vaisseaux par son sommet.
Il
est compos de deux parties bien distinctes :
-
un sac fibreux externe, aux parois paisses,
et
-
un plan de glissement fait de deux feuillets
sreux, lĠun adhre intimement au volume cardiaque et lĠmergence des gros
vaisseaux (feuillet viscral) ; tandis que l Ôautre constitue une
doublure interne au sac fibreux (feuillet parital).
Les
deux feuillets dlimitent une cavit pricardique presque virtuelle, humecte
dĠun liquide citrin et visqueux facilitant lĠexpansion du cÏur. Le feuillet
viscral constitue lĠpicarde qui recouvre extrieurement le muscle cardiaque.
Le cÏur ne remplit pas entirement la cavit pricardique, il mnage en avant,
au niveau de la base, un espace libre de 2cm quĠon exploite en cas de ponction
ou de drainage.
-
Le pricarde fibreux se prolonge par des expansions assimilables des ligaments
qui amarrent, tel un hamac, la masse cardiaque aux parois du thorax.
_________________________________________________
a : feuillet
fibreux / b : feuillet
sreux parital / c :
feuillet sreux viscral / d :
cavit pricardique
1 : lig.
Sterno-pricardique / 2 :
lig. Vertebto-peric. / 3 : Tractus fibreux du msocarde
/ 4 : cul de sac de Haller /
5 : espace
occup par le pdicule pulmonaire / 6 : lig. Phreno-peric. Lat. / 7 : lig ; xipho-peric.
8 : tronc
veineux brachio-cephalique.
|
Vue
latrale droite (dĠaprs G. Paturet)
|
Les rapports du
pricarde sont ceux du cÏur.
La face
antrieure est en rapport avec le sternum et les cartilages costaux. Sa
projection couvre une aire quadrilatre bords curvilignes, limite :
|
-
en haut par une ligne joignant la 1Ħ articulation chondro-sternale droite
la premire gauche ; -
en bas, une horizontale rasant la base de la xiphode et dpassant le bord
droit du sternum de 2 cm, et le bord gauche de quatre travers de doigt (6 8
cm); -
sur les cts, une ligne lgrement convexe joignant les extrmits des
lignes prcdentes. -
Les parties latrales de la face antrieure du pricarde ne sont pas
directement en contact avec la paroi chondro-sternale, tant recouvertes par
les culs de sac pleuraux (trac en vert) et par les bords des poumons
correspondants (trac en jaune). ____________________________________ -
La zone libre de toute interposition pleurale est en grande partie cache
derrire le sternum dont elle est spare par une
couche de tissu cellulo-graisseux. Elle le dborde un peu du ct gauche se
mettant directement au contact de lĠextrmit interne des 5Ħ et 6Ħ EIC (point
de ponction du pricarde sans risque de lser la plvre). -
Les tracs en vert ourlent la projection des cul de sacs pleuraux
mdiastino- costaux
antrieurs. -
LĠaire teinte en mauve correspond au pricarde en rapport direct avec la plvre (espace de Gehrardt). -
Les aires jaunes sont en rapport avec le poumon. |
|
- La face
postrieure rpond aux organes du mdiastin postrieur, en particulier
lĠÏsophage.
|
|
|
|
|
a : cul de sac de Haller / b : Ïsophage thoracique / c & cĠ : nerfs vagues / d &
dĠ : nerfs rcurrents / e :
veine azygos / f : ganglions
sous pricardiques
* : empreinte du cÏur
gauche/ 1 : crosse aortique /
2 : carotide primitive G / 3 : art. sous-clavire G / 4 : Ïsophage |
||
- Les bords
latraux sont au contact de la plvre mdiastine et du nerf phrnique.
- La base
adhre au diaphragme par lĠintermdiaire duquel elle rpond aux organes de
lĠtage sus mso-colique.
- Le sommet
embrasse les gros vaisseaux leur formant une gaine, celle de lĠaorte est plus
tendue en hauteur jusquĠ la partie moyenne du manubrium.