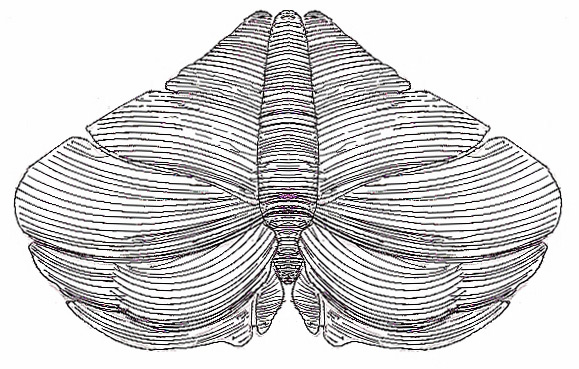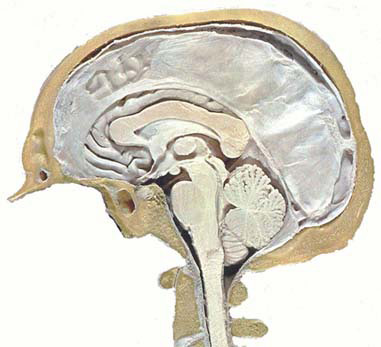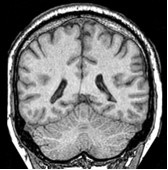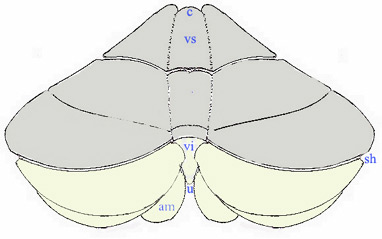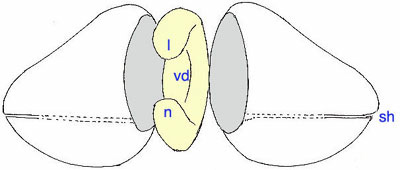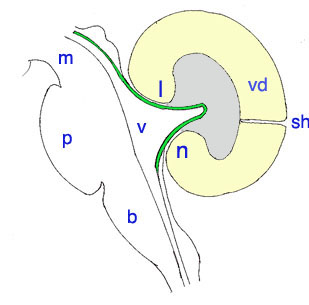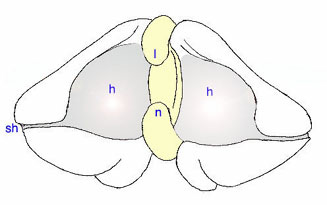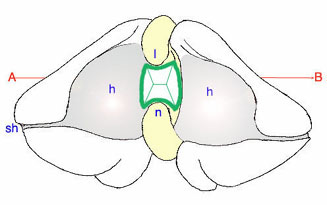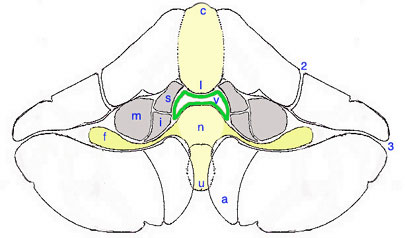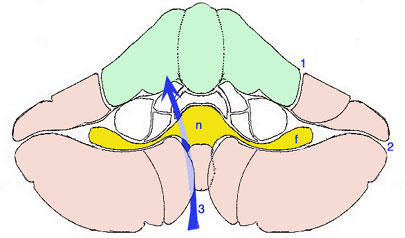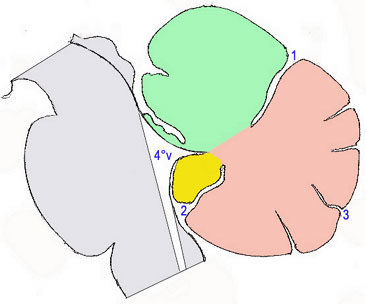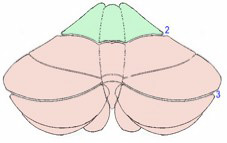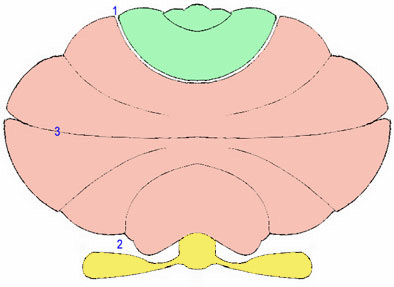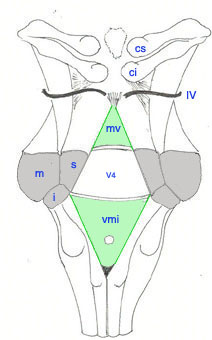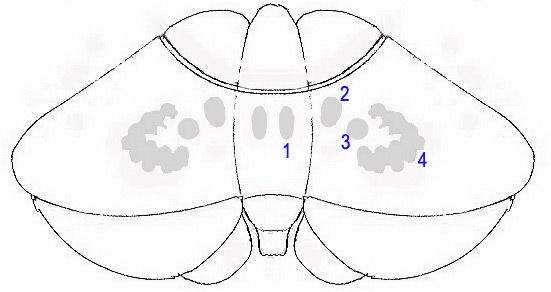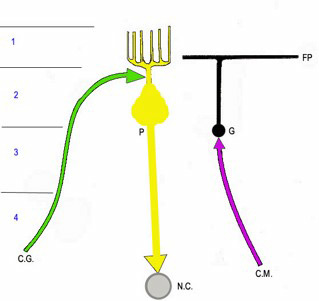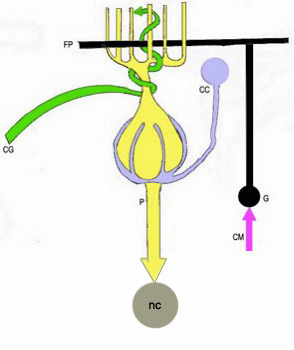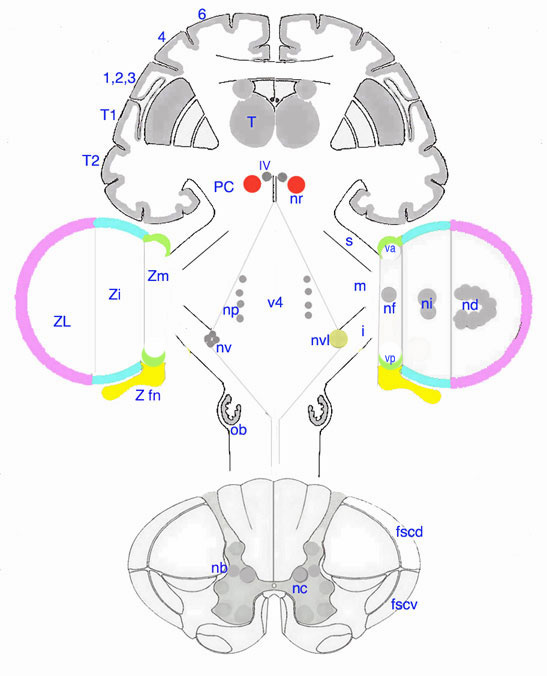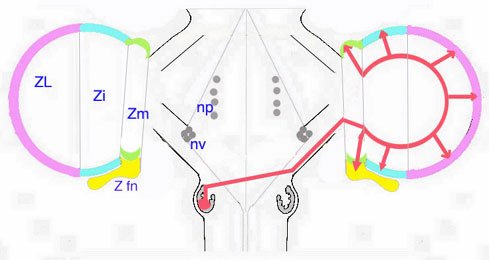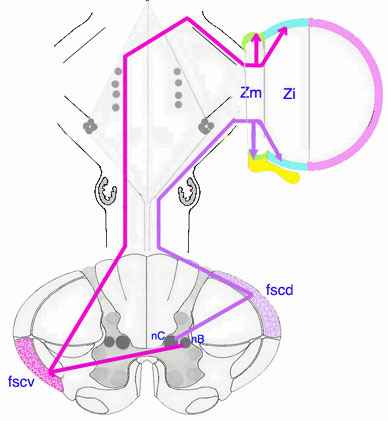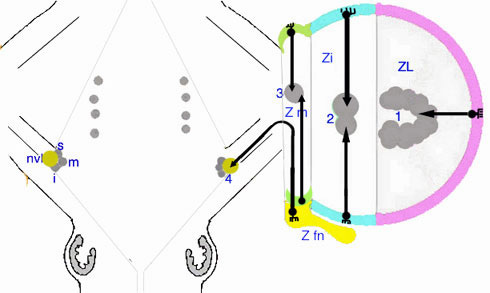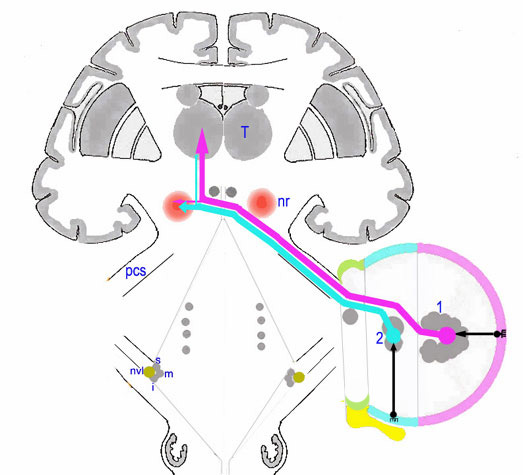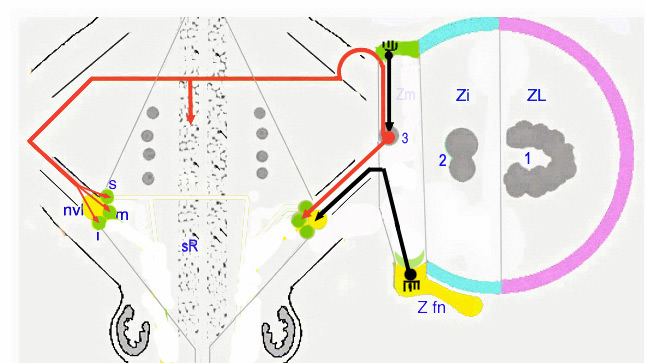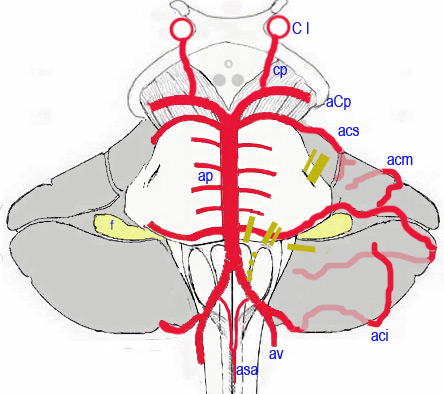T.H. Alami - 2007
Le cervelet est une volumineuse composante
de lÕencphale, impaire & mdiane, situe dans la fosse postrieure du
crne dont elle occupe lÕespace compris entre le ple occipital du cerveau et
le tronc crbral. Il est rattach
la face dorsale de ce dernier par lÕintermdiaire de trois paires de
pdoncules crbelleux.
Du point de vue anatomophysiologique, le
cervelet est situ en drivation sur les grandes voies de communication du
nvraxe. Son rle est dterminant dans le droulement du mouvement volontaire,
dans la mmorisation de la gestuelle automatique, et dans le maintien du tonus
postural.
Aspect
extrieur
|
Vu de dos, il est en
forme dÕellipse grand diamtre transversal, dcomposable en deux
hmisphres droit & gauche spars par une masse longitudinale troite,
le vermis.
Son aspect lamelleux
caractristique est d sa striation par de nombreux sillons parallles curvilignes et concentriques, aspect
nettement diffrent de celui du relief crbral. |
Sch. 01 |
| Le volume de lÕensemble
est tel quÕil masque presque la totalit de la face dorsale du tronc
crbral.
Sch. 02 - Vue dorsale
(la masse crbelleuse suppose
transparente)
|
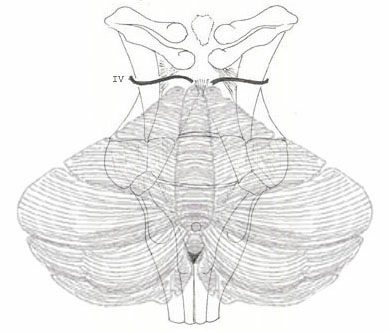 |
Une coupe mdio-sagittale de la fosse
postrieure montre lÕaspect grossirement triangulaire de la loge occupe par
le cervelet. Cet espace est dlimit par: le ple occipital en haut, le tronc
crbral en avant et lÕcaille occipitale en bas.
|
|
|
|
Imag. 01 - Coupe mdio-sagittale du crne (Atlas Sandoz)
|
Imag. 02 - Coupe mdio-sagittale de lÕencphale (CHU Rabat) |
Ces limits correspondent aux trois faces du
cervelet : une face antrieure ou ventrale (c) rattache au tronc crbral
(tc), et deux faces dorsales, dlimite par une crte, la face suprieure (a)
moule contre la tente dure-mrienne qui la spare du cerveau, et la face
infrieure (b) applique contre le squelette occipital.
- La face suprieure est souleve par
le relief du vermis sparant les deux surfaces hmisphriques presque planes et
inclines en toit pentu. Cette face est limite par le grand sillon horizontal
(sh)), profond, dont la rgularit est
entame par lÕtroite chancrure dorsale. vermien
|
Imag. 03 - Coupes mdio-sagittale & frontale passant par la fosse postrieure – (CHU Rabat) |
Sch. 03 - Vue dorsale faces suprieure(en gris) & infrieure
(en jaune) c : culmen ; vs : vermis suprieur ; vi : vermis infrieur sh :
sillon horizontal ; u : uvule ; am : amygdale |
La striation de cette face dtermine
plusieurs territoires dont le lobule form par lÕextrmit du vermis suprieur
(vs), le culmen (c).
- La face infrieure est marque par
lÕchancrure mdiane occupe en profondeur par le vermis infrieur (vi) dont
lÕextrmit distale est dnomm luette ou uvule (u) appendue entre les deux
lobes amygdaliens (am).
-
La face ventrale se
continue insensiblement avec la face infrieure, elle est applique contre la
face dorsale du tronc crbral auquel elle est rattache par de multiples
amarres.
La mise en place de ces dernires fera appel une structure virtuelle
modulaire qui rduirait le cervelet -
observ par sa face ventrale – deux cnes disposs transversalement
et spars par une masse longitudinale en forme de C dont lÕouverture est
oriente vers lÕobservateur.
|
Sch.04
Modules observs par leur
face ventrale
|
Sch.05 Module vermien de profil
adapt la face dorsale ;du tronc crbral |
|
La partie convexe du C
est le vermis dorsal (vd). Ses extrmits libres, en forme de crochets, correspondent au vermis ventral,
discontinu, fait de deux lobes : la lingula (l) en haut & le nodule
(n) en bas. LÕouverture du C est lÕespace qui sera occup par le diverticule
du 4¡ ventricule (v) comme il figure sur le schma de droite. |
|
|
Ayant contourn le bord
latral des hmisphres, les extrmits du sillon horizontal (sh)
bifurquent mi-chemin, limitant
chaque ct une fossette dont le creux est accentu par le relief central
que forme la saillie du vermis ventral. Les deux fossettes constituent le
hile (h) travers lequel passent les formations reliant le cervelet au tronc
crbral, cÕest--dire les pdoncules crbelleux. |
||
|
Sch.06 Dlimitation des fossettes
hilaires |
Sch.07 Mise en place du
diverticule ventriculaire |
|
|
La zone vermienne centrale
sera occupe par le diverticule du toit du 4¡ ventricule qui sÕenfonce dans la masse du vermis
ventral et dont la disposition accentue le creux de chaque fossette hilaire. Dans lÕensemble, cette
face ventrale comporte une aire
libre de toute attache (en
blanc), elle circonscrit le hile (teint en gris), insparable du tronc
crbral. |
||
|
A-B met en
vidence : - lÕangle
ponto-crbelleux (apc) que dlimitent lÕaire libre de la face ventrale du
cervelet & la face latrale du pont. - la fossette hilaire
occupe sur ce niveau de coupe
par le pdoncule crbelleux moyen (m). - le 4¡ ventricule
paroi ventrale pontique & dorsale vermienne. |
Sch.08 Coupe horizontale niveau
AB |
|
|
Considrons lÕaspect plus labor de cette face ventrale. Le vermis ventral est
reprsent sur ce schma par : -
les
deux crochets du C, celui du haut sÕtend du culmen (c) la lingula (l). -
Le
crochet infrieur est constitu par le nodule (n) dÕo partent les deux
floccules (f) ; son extrmit caudale est la luette ou uvule (u)
intercale entre les deux amygdales (a).
Sch.09 – Apect ventral -
Impaire
et mdian, le diverticule ventriculaire (v) occupe lÕespace compris entre les
deux hiles, la lingula (l) & le nodule (n). -
Les
pdoncules crbelleux amarrent les hmisphres aux tages du tronc crbral,
ce sont de chaque ct les trois pdoncules crbelleux, suprieur (s),
infrieur (i) & moyen (m), ce dernier tant le plus volumineux. |
Topographie
lobaire
LÕaspect extrieur du cervelet est
remarquable par la multiplicit des stries & sillons transversaux dont les
degrs de profondeur dlimitent des territoires dÕingales tendues.
Les lobes sont dlimits par des
sillons de premier ordre ou fissures dont la profondeur atteint la substance
blanche ; les sillons de deuxime ordre sont superficiels, ils nÕentament
que la substance grise et dlimitent des lobules subdiviss leur tour en
lames et lamelles.
Une foliole est un territoire compris
entre deux sillons transversaux et comprenant un lobe vermien reli de chaque
ct un lobe hmisphrique.
La distinction dÕune vingtaine de lobes
emprunte lÕanatomie compare, a peu dÕintrt du point de vue
anatomo-fonctionnel ou clinique. Par souci de simplification, on retiendra les
trois lobes dtermins par les deux principales fissures.
|
Sch.10 – trac de la fissure postro-latrale |
Sch.11 - Coupe sagittale du vermis |
|
La premire apparatre
au cours du dveloppement embryonnaire est la fissure postro-latrale (1),
perceptible au niveau de la face ventrale du cervelet aprs section de ses
attaches au tronc crbral ; elle spare le lobe flocculo-nodulaire (n f) du
reste de lÕorgane. LÕautre fissure est
nettement visible sur la face dorsale, cÕest la fissure primaire (2) qui
dlimite le lobe antrieur. Le volume compris entre ces deux fissures
constitue le lobe
postrieur |
|
|
Ces trois principaux
lobes sont lÕexpression topographique du dveloppement phylognique du
cervelet, ils correspondent aux structures dsignes par les termes :
archo-cerebellum, paleo-cerebelluml & no- cerebellum, terminologie en
usage en anatomie compare. Sch.12 - Aspect dorsal |
|
|
Le schma ci-contre
reproduit le planigramme de Larsell qui rsume la topographie des trois
principaux lobes & fissures. - Lobe antrieur (en vert) - lobe postrieur (en rose) -
complexe floculo-nodulaire (en jaune) |
Sch.13 – Planigramme de Larsell |
Les
pdoncules crbelleux
sont
trois paires de cordons de substance blanche disposs symtriquement de
part & dÕautre du 4¡ ventricule. Leurs fibres constitutives relient le
cervelet aux tages correspondants du tronc crbral (msencphale, pont &
bulbe), dÕo leur distinction en
pdoncules crbelleux suprieurs (s), moyens (m) & infrieurs (i).
|
Sch.14 – face dorsale du
tronc crbral |
Sch.15 – Disposition des
pdoncules crbelleux leur origine |
|
Leur origine apparente
nÕest visible quÕaprs section mdio-sagittale du vermis suivie de la bascule
des hmisphres. La face dorsale du tronc crbral ainsi expose, on note la
confluence des pdoncules crbelleux suprieurs & infrieurs masquant
les moyens, ces derniers tant plus ventraux. |
|
- Les pdoncules crbelleux suprieurs
(brachium conjonctivum) sÕtendent du cervelet lÕtage rostral du tronc
crbral. Ë leur origine, ils sont runis transversalement par la membrane de
Vieussens (mv) qui recouvre le versant suprieur du toit, ils surcroisent les
pdoncules infrieurs, puis sÕorientent en haut et en dedans vers le
msencphale, puis disparaissent sous la plaque coliculaire. Auparavant, leurs
fibres sÕentrecroisent sur la ligne mdiane (dcussation de Wernekink) avant de
se terminer dans le noyau rouge & le thalamus du ct oppos.
- Les pdoncules crbelleux moyens (bras du
pont) sont les plus volumineux ; les fibres constitutives sont des affrences provenant exclusivement
des noyaux du pont du ct oppos.
La face antro-latrale de chaque pdoncule
est au contact du rocher, le sillon horizontal aboutit cette face juste
au-dessus du flocculus.
- Ë lÕorigine, chaque pdoncule crbelleux
infrieur est plac entre les deux autres, le suprieur en dedans & le
moyen en dehors. Leurs fibres s Ôindividualisent sur la face latrale du bulbe
en un cordon court appel corps restiforme. Ce dernier est form de
fibres dÕorigine mdullaire & bulbaire qui vhiculent les sensibilits proprioceptives
inconscientes. Un autre contingent de fibres longe son flanc mdial, dnomm corps
juxta-restiforme, elles sont exclusivement de nature vestibulaire.
La
structure interne
est schmatise sur une coupe transversale
allant dÕun hmisphre lÕautre.
Les neurones sont agglomrs au niveau du cortex et des noyaux
crebelleux.
- Le cortex est dcoup en
circonvolutions par des sillons transversaux parallles.
pais de 1 mm, son architecture est moins
complexe que celle du cortex crbral ; de plus sa structure est identique
dÕun hmisphre lÕautre, vermis compris.
- La substance blanche, masse de parenchyme de
forme trapzode, est le centre mdullaire du cervelet. Elle
envoie la priphrie des lamelles en rayons de roue dÕo partent des
branches, lÕaspect de lÕensemble sur une coupe sagittale fut qualifi dÕarbre
de vie.
Elle est constitue par de la nvroglie
& par des fibres nerveuses qui forment les pdoncules crbelleux, celles des pdoncules moyens tant
prdominantes.
- Les noyaux, au nombre de quatre
paires sont disposs de part & dÕautre de la ligne mdiane ; ce sont:
|
|
|
Sch.16 - Disposition des noyaux
travers lÕaspect dorsal du cervelet suppos transparent |
-
le
noyau du toit ou noyau fastigial (1Õ), situ prs de la ligne mdiane au
contact du diverticule du toit du 4e ventricule ;
-
le
globule (2) en dehors du prcdent;
-
le
noyau dentel (4) ou olive crbelleuse semblable celle de bulbe et
dont le hile est
orient vers le toit du 4me ventricule et la ligne mdiane ;
-
le
noyau emboliforme, en en regard du hile du prcdent.
Par convention, on regroupe les deux noyaux,
globule & emboliforme, sous le terme de noyaux intermdiaires ou
interposs.
Topographie
zonale
Les connexions entre les structures intra
crbelleuses permettent de dcomposer chaque moiti de cervelet en quatre
territoires ou zones anatomo-fonctionnelles, comportant chacune un cortex, la
substance blanche sous-jacente & la structure nuclaire qui lui est
annexe. cette topographie anatomo-fonctionnelle est schmatise sur le
planigramme de Larsell :
|
Sch.17 – Position des
noyaux travers le planigramme suppos transparent. |
-
La
zone mdiale (Zm) est la tranche vermienne avec son noyau
fastigial.
-
La
zone intermdiaire (Zi), relativement troite, correspond la tranche
mdiale de lÕhmisphre, avec ses deux noyaux interposs & la substance
blanche environnante.
-
La
zone latrale (ZL), la
portion la plus volumineuse de lÕhmisphre, avec son cortex plus tendu, son
noyau dentel et la substance blanche correspondante ; &
-
la
zone ou lobe floculo-nodulaire (Z fn) auquel on adjoint le noyau
vestibulaire latral (qui serait un noyau crbelleux ectopique).
Aperu
histologique du cortex crbelleux
Les affinits tinctoriales font ressortir
trois couches cellulaires :
-
la plus superficielle, dite molculaire,
est riche en fibres orientes horizontalement,
-
lÕintermdiaire
ou glomrulaire est occupe par une seule range de cellules de Purkinje,
-
la
couche profonde (granulaire) est caractristique par sa richesse en minuscules
interneurones appels grains.
La cellule de Purkinje, volumineux neurone
piriforme non pigment, est
spcifique du cervelet. Ses dendrites sÕpanouissent dans la couche superficielle,
tandis que lÕaxone traverse la couche granulaire en direction dÕun des noyaux
crbelleux o il se termine.
Les deux autres couches
sont peuples de nvroglies & dÕinterneurones de diffrents aspects
(grains,cellules corbeille, cellules de Golgi) dont les prolongements
tablissent, directement ou indirectement, des connexions avec les cellules de
Purkinje.
|
Sch.18 - Arrangement des
neurones corticaux |
|
|
-
1 :
couche superficielle (molculaire) -
2 :
range des cellules de Purkinje (couche glomrumaire) -
3 :
couche profonde (granulaire) -
4 :
zone mdullaire |
P : Cellule de Purkinje C.G : Cellule grimpante C.M : Cellule moussue G : Grain FP : Fibre parallle N.C : Noyau crbelleux |
Principes
dÕorganisation neuronale
- Ë quelques exceptions prs, les pdoncules
crbelleux moyens & infrieurs sont les portes dÕentre des informations
destines au cervelet. Par contre, toutes les fibres effrentes le quittent par
le pdoncule crbelleux suprieur.
- Les affrences aboutissent principalement au
cortex.
- La cellule de Purkinje est interpose entre les
fibres affrentes & effrentes.
- Toute information manant du cortex crbelleux
passe par la cellule de Purkinje qui la transmet un des noyaux dÕo elle est
projete hors du cervelet via les pdoncules crbelleux suprieurs.
a- Les fibres affrentes se distinguent en grimpantes
ou moussues selon leur mode de connexion avec les cellules de Purkinje.
- Les fibres grimpantes sont les axones
provenant de lÕolive bulbaire contro-latrale ; elles
aboutissent au cervelet par le PCI
et se terminent sur toutes lÕtendue du cortex.
Chaque fibre aborde une cellule de
Purkinje et ÔgrimpeÕ jusquÕau contact de ses dendrites avec
lesquelles elle tablit des
synapses.
- Les fibres moussues sont les axones issus
des autre noyaux du tronc crbral &
de la moelle.
Elles se terminent dans le cortex crbelleux
o elles tablissent des
connexions indirectes
avec les cellules de Purkinje par
lÕintermdiaire des grains.
|
Sch.19 – circuit neuronal |
-
CC :
Cellule corbeille, mode synaptique avec le corps de la cellule de Purkinje. -
G : Grain & fibres
parallles par bifurcation de son axone, synapse avec dendrites de P. -
CM :
Axone de cellule moussue issue de noyau autre que lÕolive bulbaire. -
CG :
Fibre grimpante, axone issu de lÕolive bulbaire, synapse avec dendrite de P. -
nc :
noyau crbelleux. |
Il est intressant de noter quÕun contingent de
fibres affrentes, grimpantes & moussues, transitent par ces noyaux avant
dÕaboutir au cortex. Les interconnexions ainsi cres dans les deux sens
refltent la particularit de ces structures nuclaires qui sont plus que des
relais.
b- Les fibres effrentes manant du cortex sont
reprsentes exclusivement par les axones des cellules de Purkinje, elles se
terminent dans les noyaux crbelleux (nc).
Systmatisation
Le schma sous-jacent sera utilis, en
totalit ou en partie, comme
canevas des connexions tablies entre le cervelet & le nvraxe. Ce dernier
est reprsent en coupe frontale, schmatis lÕextrme, y figurent les
repres utiles au trac des diffrentes voies.
|
Sch.20 – Canevas du nvraxe |
||
|
Dchiffrer les lgendes partir du
haut : - Les chiffres : numrotation des aires corticales fronto-parito- temporales.. - T : Thalamus - PC : Pdoncule Crbral - nr : noyau rouge - s, m, i : pdoncules crbelleux
sup., moyen & infer. - v4 : Losange dlimitant le 4¡
ventricule - np : noyaux pontiques - nf : noyau fastigial |
- ni : noyaux interposs - nd : noyau dentel - nv : noyaux vestibulaires - nvl : noyau vestibulaire latral - :ZL : Zone latrale - Zi : Zone intermdiaire - Zm ; Zone mdiale - Zfn : Zone floculo-nodulaire - ob : olive bulbaire - nC : noyau de Clarke - fscd : faisceau spino-crbelleux
dorsal - fscv : faisceau spino-crbelleux
ventral |
|
1- Les voies affrentes
partent de tous les niveaux du
nvraxe (cortex crbral, noyaux du tronc crbral & de la moelle).
|
Sch.21
La voie
olivo-crbelleuse aboutit au cervelet par le PCI ; les fibres
constitutives, toutes de type grimpant, proviennent de lÕolive bulbaire (ob)
contro-latrale, croisent la ligne mdiane et se distribuent toute
lÕtendue du cortex crbelleux. LÕolive bulbaire est un important relais de la
voie extra-pyramidale par o transitent les instructions issues du cortex
crbral, du noyau rouge & de la moelle. |
La voie vestibulo-crbelleuse
est forme de fibres provenant principalement des
noyaux vestibulaires latral (D) & mdial (S) ainsi que de fibres priphriques issues du ganglion de
Scarpa.
Sch.22
-
nv : noyaux vestibulaires
-
PCI : Pdoncule crbelleux infrieur, dcompos en corps restiforme (a)
& juxta-restiforme (b)
* en
encadr :
-
le nerf VIII se distribue aux quatre noyaux vestibulaires (nv) : mdial
(de Schawlbe = S), latral (de Deiters = D),
-
cJR : corps juxta-restiforme form par les affrences provenant directement du nerf
vestibulaire (VIIIv).
|
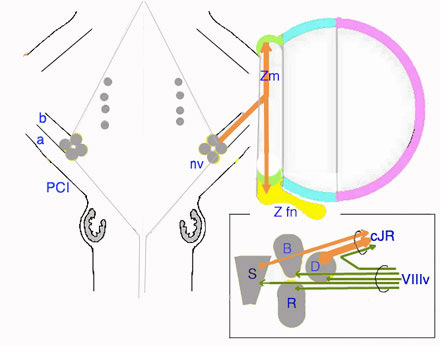 |
Elles cheminent transversalement sous le plancher
du 4¡ ventricule, traversent lÕaile blanche externe et deviennent ascendantes
en direction du PCI. Leur regroupement au sein de ce dernier forme un faisceau
dense bien individualis sous le nom de corps juxta-restiforme (cJR) qui se projette
sur le cortex des zones mdiale & flocculo-nodulaire homolatrales.
La voie
cortico-crbelleuse
est interrompue au niveau des noyaux du pont (np).
Le tronon cortico-pontique part des aires motrices
et sensitives primaires, des aires prfrontales, paritale & sensorielles.
Les fibres du tronon ponto-crbelleux constituent
le volumineux pdoncule crbelleux moyen, elles se projettent sur le cortex
des zones intermdiaire & latrale.
Les instructions provenant du cortex moteur (aire
4) aboutissent la zone intermdiaire, tandis que celles issues cortex
crbral prmoteur (aire 6) se destinent la zone latrale.
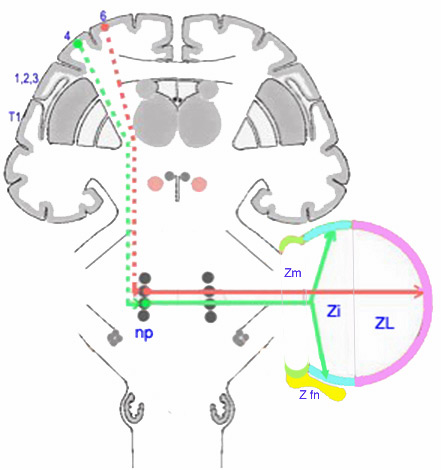
Sch.23
La voie
spino-crbelleuse
|
vhicule les sensibilits
proprioceptives issues des tguments, des muscles & des articulations,
elle comporte deux faisceaux : - Le faisceau spino-crbelleux
dorsal (FSCD) est direct. Il relie la
colonne de Clark (nC) homolatrale
au cortex des zones mdiale (Zm) & intermdiaire (Zi). Il est situ la
priphrie du cordon latral, en dehors du faisceau pyramidal crois
& du faisceau rubro-
spinal. Il garde sa situation marginale jusquÕau flanc du bulbe, puis
passe dans le
cervelet travers le corps restiforme.
- Le faisceau spino-crbelleux ventral
(FSCV) est crois. Ses fibres,
issues de la colonne de
Betcherew (nB), passent de lÕautre ct travers de la commissure grise,
traversent la base de
la corne antrieure pour aboutir la zone marginale du cordon
antro-latral, entre le
faisceau dorsal & lÕmergence de la racine antrieure. Devenu
ascendant, le faisceau traverse la rticule du bulbe, passe en dedans du PCS en
longeant le bord latral de la valvule de Vieussens et se termine dans le
cortex
crbelleux des zones mdiale & intermdiaire. |
- Les affrences dÕorigine bulbaire
proviennent des noyaux cuniforme accessoire et du noyau sensitif du
trijumeau ;
elles se terminent dans le cortex mdial & intermdiaire
en passant par le PCI.
|
Les connexions
cortico-nuclaires intra-crbelleuses fonctionnent sur le mode zonal. CÕest ainsi que le cortex
de chaque zone est en relation avec un noyau correspondant.
Sch.25 Dans lÕensemble, lÕinformation labore au niveau du cortex crbelleux est
transmise aux noyaux par lÕintermdiaire des cellules de Purkinje, elle est
ensuite achemine vers le
thalamus, le noyau rouge &
les noyaux vestibulaires. |
|
- Les effrences issues des noyaux interposs
et dent
constituent le pdoncule crbelleux suprieur. Celui-ci sÕoriente en haut et
en dedans en direction des collicules postrieurs avant de disparaitre sous
la plaque tectale du msencphale. CÕest au niveau de la calotte pdonculaire, la
hauteur de lÕorigine du nerf IV, que lÕÕensemble des fibres sÕentrecroisent
avec celles du ct oppos.. Aprs cette dcussation (e Wernekink) les fibres se rpartissent en deux
faisceaux : - Le faisceau dento-thalamique monte
directement vers le thalamus o il aboutit aux noyaux moteurs dÕo lÕinformation est
projete sur le cortex crbral.
- LÕautre faisceau, crbello-rubrique se termine dans le noyau
rouge, principale composante de la voie extra- pyramidale.
Sch.26 Cependant, cette rpartition des fibres du PCS
nÕest pas aussi tranche, certaines provenant des noyaux interposes se
projettent pour la plupart sur le noyau rouge ; tandis que presque la
totalit des fibres issues du noyau dent sont thalamophiles. |
|
-
Les
fibres issues du noyau fastigial se projettent sur les noyaux vestibulaires des
deux cts ainsi que sur la substance rticule du ct oppos. Les fibres
homolatrales quittent le cervelet par le corps juxta-restiforme, tandis que
les autres croisent la ligne mdiane lÕintrieur du cervelet enjambent le PCS
(formant le faisceau en crochet) et se dirigent vers le corps
juxta-restiforme oppos.
Sch.27 |
Projections mdullaires des
effrences crbelleuses
Les projections du cervelet sur les diffrents
niveaux du nvraxe initient pour une grande part la voie finale de la motricit
volontaire & extra-pyramidale qui aboutit la moelle.
Ce dernier chapitre abordera brivement la destine
des informations ou instructions parvenues partir du cervelet aux structures
nuclaires reprsentes par : le thalamus, le noyau rouge, les noyaux
vestibulaires & substance rticule.
- Les noyaux moteurs du thalamus projettent lÕinformation labore au
niveau du cervelet sur le cortex crbral prmoteur puis sur lÕaire 4 dÕo part la voie de la motricit
volontaire.
Cette dernire relie directement le cortex crbral aux motoneurones des nerfs
crniens & rachidiens par les deux faisceaux, gnicul & pyramidal.
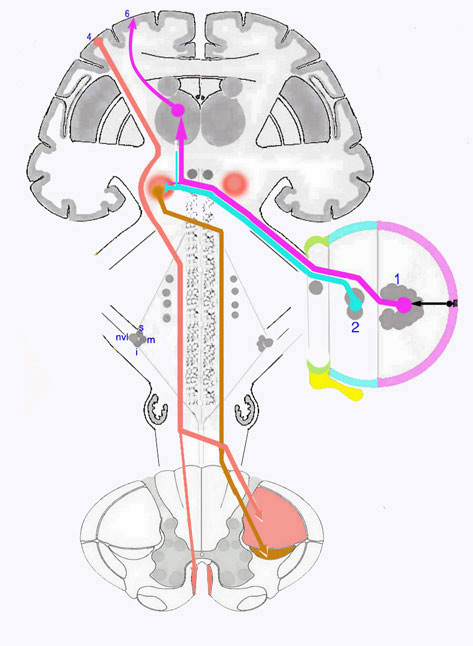
Sch.28
Les fibres de la voie
pyramidale se rpartissent au niveau bulbaire en deux contingents, le plus
volumineux croise la ligne mdiane, cÕest le faisceau cortico-spinal crois (fcsc)
qui passe dans le cordon latral de la moelle, adoss la corne dorsale du
ct oppos. Le reste des fibres constitue le faisceau cortico-spinal direct
(fcsd) qui garde sa position antrieure de la moelle tout contre la fissure
mdiane.
- Les fibres issues des noyaux interposs croisent
la ligne mdiane et se termine dans le noyau rouge controlatral dÕo part le faisceau rubro-spinal (de von Monakow),
principale composante de la voie extra- pyramidale.
Ce faisceau sÕindividualise au niveau de la calotte
pdonculaire aprs dcussation (de Forel). Il aboutit au cordon latral de la
moelle o il se place en avant du faisceau pyramidal crois quÕil accompagne
sur tout son trajet, dÕo son autre nom de faisceau pr-pyramidal.
- La voie vestibulo-spinale emprunte deux
faisceaux :
* le
faisceau vestibulo-spinal latral (fvsl) est direct, il nat du noyau
vestibulaire de Deiters (D),
principal centre rflexe de lÕquilibration.
Il descend dans le cordon antrieur de la moelle
jusquÕau niveau lombaire.
* le faisceau vestibulo-spinal mdial (fvsm)
nat principalement du noyau vestibulaire infrieur du
ct oppos. Ses fibres se mlent celles
de la bandelette longitudinale postrieure (*).
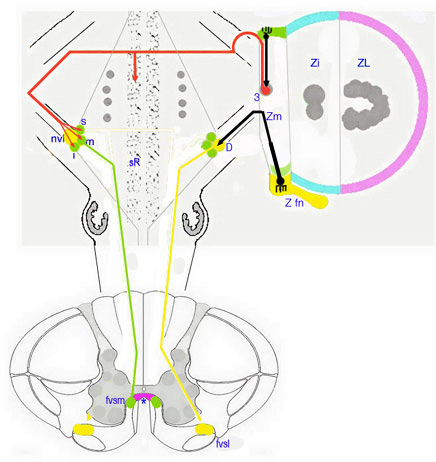
* Le faisceau rticulo-spinal est issu. Il provient des
synapses tablies entre la
substance rticule grise du tronc crbral & le faisceau crbello-vestibulaire (en crochet).
-
le
faisceau pontin (f p) provient de la rticule protubrantielle, il se termine
dans le cordon latral de la moelle o il se situe en avant de la corne
antrieure.
- Le faisceau bulbaire (f b), issu des noyaux rticulaires distaux, se place en dedans de la corne antrieure, devant le faisceau vestibulo-spinal mdial.
Certaines de ses fibres font relais dans lÕolive bulbaire.
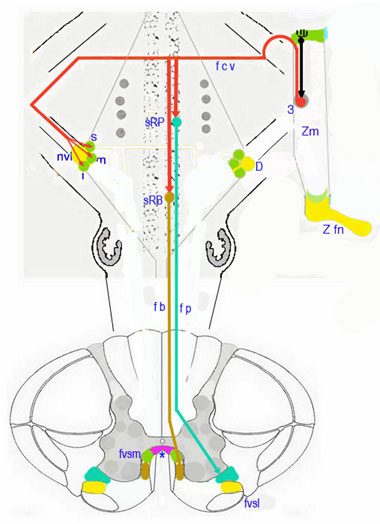
Sch.30
Rapports
Le cervelet est situ dans la fosse postrieure, loge osto-fibreuse inextensible, limite :
- en haut par la tente du cervelet qui la spare du ple occipital du cerveau ;
- en bas par la base du crne en arrire de la selle turcique ( gouttire basilaire, face postrieure des rochers & cailles mastodiennes) ;
- en arrire par lÕcaille de lÕoccipital.Cette loge comporte deux orifices de communication :
- le trou occipital, osseux, occup par le bulbe, &
- le trou ovale (foramen ovale de Paccioni), osto-fibreux amnag par les insertions de la tente du cervelet.
Outre le cervelet, cette loge est occupe par le segment bulbo-protubrantiel du tronc crbral & par les deux espaces ou angles ponto-crbelleux quÕils dlimitent entre eux.
LÕangle ponto-crbelleux est un espace paramdian exigu & profond, dlimit de chaque ct par la protubrance reprsente principalement par le PCM, la partie rostrale de la face latrale du bulbe, & par la face ventrale de lÕhmisphre crbelleux.
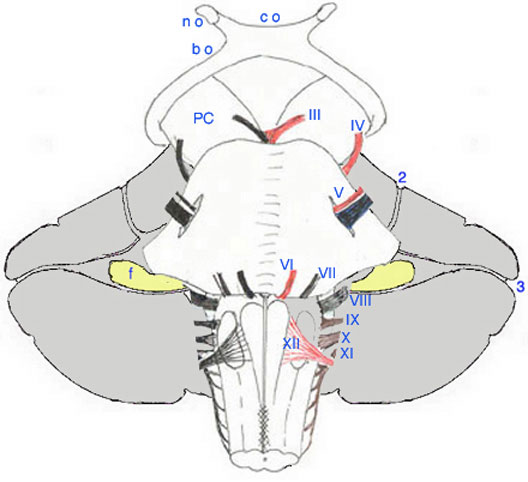
Sch.31 Ð Aspect ventral
Il est occup par le prolongement latral de la citerne pontique, par le flocculus qui masque le plexus chorode latral du 4¡ ventricule, par de nombreux nerfs & par des vaisseaux crbelleux. CÕest ce niveau que se dveloppent les tumeurs de la VIII¡ paire
(neurinomes de lÕacoustique).
Les troncs nerveux ont une disposition cardinale : trs en dedans le VI, en haut le trijumeau, en dehors le faisceau acoustico-facial dirig vers le pore auditif interne, &
en bas le groupe des nerfs mixtes (IX-X-XI) orients vers le trou dchir postrieur.
LÕaspect endocrnien de cette de la loge crbelleuse met en vidence les repres suivants:
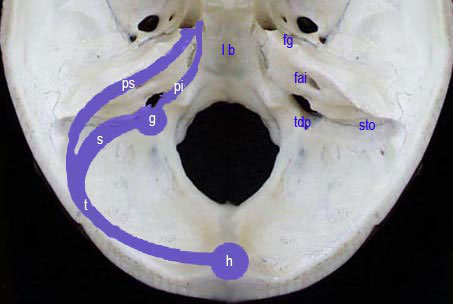
Sch.32
l p : lame basilaire
f g : fossette du gg. de Gasser
fai : foramen auditif interne
tdp : trou dchir postrieur
sto : suture temporo-occipitale
ps : sinus ptreux suprieur
pi : sinus ptreux infrieur
g : fossette du golfe de la jugulaire
s : sinus sigmode
t : sinus transverse
h : pressoir dÕHrophile (Torcular)
Les troncs nerveux issus du tronc crbral (pont & bulbe) sont tags de haut en bas :
V : les deux branches du Trijumeau
VI : nerf oculaire externe
VII & VIIÕ : nerfs Facial & Accessoire
VIII : nerf Auditif (acoustico-vestibulaire)
IX : Glossopharyngien
X : Pneumogastrique
XI : Spinal bulbaire
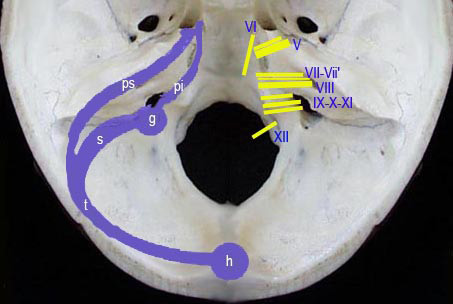
Sch.33
* Le rseau veineux est reprsent par les collecteurs occupant des espaces dure-mriens appels sinus.
- Les sinus ptreux suprieur & infrieur suivent les bords correspondants de la face mdiale du rocher.
- Le sang veineux de la vote est collect au niveau du torcular (h) qui se dverse dans le sinus transverse puis dans le sinus sigmode. En fin de parcours, le sang veineux aboutit au golfe de la jugulaire, point de dpart du retour du sang veineux crbral vers le cÏur.
Les troncs nerveux en rapport avec lÕespace ponto-crbelleux sont issus des tages pontique & bulbaire du tronc crbral. Leur disposition spatiale est grossirement cardinale :
- en haut, le nerf trijumeau se dirige vers le ganglion de Gasser relais ganglionnaire de sa
racine sensitive ;
- en bas, les trois nerfs mixtes (IX, X, XI) orients vers le trou dchir postrieur ;
- plus en dedans, le VI ,
- en dehors, trois autres nerfs : le facial, le nerf de Wrisberg & le nerf acoustico-vestibulaire
orients vers foramen auditif interne. Ils constituent le principal constituant de cet espace.
Le mme schma voque le foramen de Pacchioni ( * ), anneau osto-dure-mrien qui cravate le msencphale (mes).
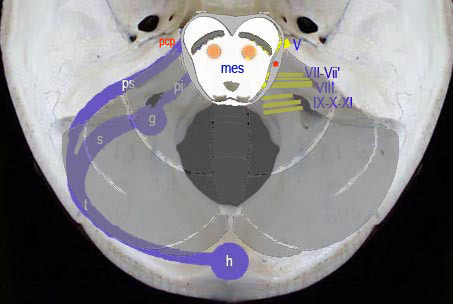
Sch.34
Les mninges molles recouvrent les moindres reliefs du cervelet tout en dlimitant dÕimportants espaces l o la masse crbelleuse sÕloigne du plan dure-mrien. Il en rsulte la constitution de vastes citernes :
- deux mdianes : le lac crbelleux postro-suprieur dÕune part, & la citerne bulbo-crbelleuse ou grande citerne dÕautre part ;
- une citerne antro-latrale, ponto-crbelleuse, paire & symtrique,
Les artres
La vascularisation du cervelet est assure
principalement par trois paires de branches issues des artres vertbrales
& de leur confluent le tronc basilaire; ce sont les artres crbelleuses
suprieures, moyennes & infrieures, flexueuses & finement anastomoses
entre elles.
-
LÕartre
crbelleuse infrieure est la plus grle, elle nat de la vertbrale la
hauteur du relief olivaire, croise lÕorigine du XII puis sÕengage entre
lÕamygdale & le bulbe quÕelle contourne, longe le bord du vermis infrieur
et se termine sur la face infrieure de lÕhmisphre crbelleux. Les rameaux
qui sÕen dtachent, sinueux, se distribuent ce territoire, principalement au
noyau dentel, ainsi quÕau complexe floculo-nodulaire, au bulbe, au corps
restiforme & aux plexus chorodes dont ils constituent la principale source
vasculaire. Le rameau destin au vermis infrieur (artre crbelleuse
postro-infrieure) est un prcieux repre en radio-encphalographie.
|
Sch.35 |
-
LÕartre
crbelleuse moyenne se dtache du tronc basilaire la hauteur du trou
borgne, directement, mais plus souvent dÕun tronc commun avec lÕartre auditive
interne. Elle chemine sur la face ventrale du pont paralllement au sillon
bulbo-protubrantiel & au-dessous de l Ômergence du V. Elle se
termine par des rameaux le long du sillon circonfrentiel de chaque hmisphre.
-
LÕartre crbelleuse suprieure
est la plus volumineuse, elle nat du tronc basilaire, prs de sa bifurcation
dont elle est spare par l Ômergence du nerf III. elle longe le bord
suprieur de la protubrance, contourne le pdoncule crbral et aborde la face
dorsale du cervelet sur laquelle elle se ramifie en ventail. Dans son trajet
curviligne, elle est accompagne du nerf IV qui lui est sous-jacent. elle se
distribue principalement la face suprieure du cervelet, au vermis suprieur,
la valvule de Vieussens ; Un de ses rameaux est destin au noyau
dentel.
Les veines
Les rseaux veineux ne se superposent pas ceux
des artres. Les troncs veineux constitus partir de la superficie du
cervelet aboutissent aux sinus dure-mriens & la veine de Galien.
Ils contribuent ainsi son amarrage la tente
dure-mrienne qui le recouvre, ainsi quÕaux rseaux priphriques
LÕaspect gnral du cervelet permet de dcrire deux
rseaux principaux, un rseau vermien & un rseau hmisphrique.
* Le rseau vermien est dorsal, il comprend :
- les veines vermiennes antrieures,
volumineuses ; elles drainent le sang du vermis
suprieur et des
structures avoisinantes (valvule de Vieussens, pdoncule crbelleux
suprieur & plaque
tectale). Elles aboutissent la veine de Galien.
- les veines postrieures occupent lÕchancrure crbelleuse, elles
naissent du vermis
infrieur et des amygdales.
Elles se dversent dans le pressoir dÕHrophile (torcular) &
dans lÕextrmit du sinus
droit.
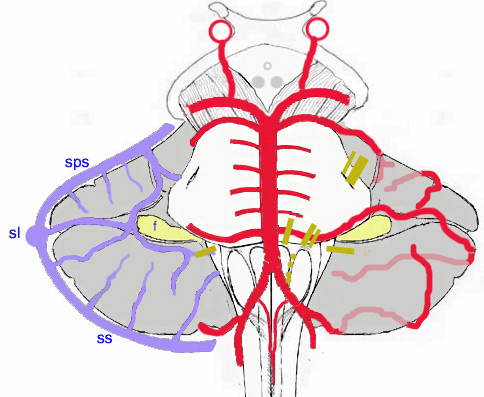
* Le rseau hmisphrique comprend une
demi-douzaine de veines flexueuses, organises
en
veines para-mdianes & veines latrales.
- Les veines
paramdianes drainent le sang du lobe antrieur, du hile crbelleux, du
noyau dentel, des pdoncules moyens et
du bord latral du bulbe. Les
veines
constitutives
se regroupent autour du flocculus et confluent en un tronc commun qui
occupe
le segment ventral du sillon horizontal. Il se dverse dans le sinus ptreux
infrieur.
Les veines pri-flocculaires se rsolvent en un tronc (veine de Dandy) qui
aboutit
au sinus ptreux infrieur.
- les veines
latrales se dversent dans les sinus contigus (ptreux, latral &
sigmode).